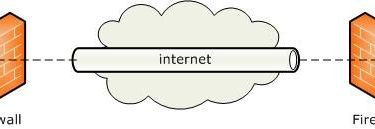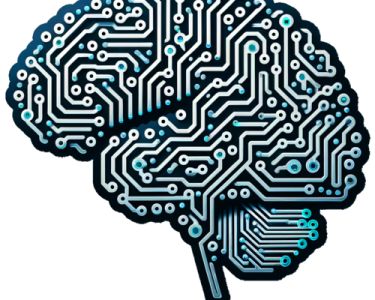Le monde de demain sera-t-il celui d’hier, voire d’avant-hier : en tout cas, ni le progressisme, ni l’européisme, ni le mondialisme ne font plus recette, car le Covid-19 les a contaminés. Ceux qui marchaient vers un avenir radieux se sentent fiévreux et affaiblis, affaiblis dans leurs certitudes et dans leur arrogance. Depuis quelques jours, les mots d’ordre se sont inversés. Le renversement le plus fort est celui de la préférence que les belles âmes, le Pape en particulier, avaient manifestée en faveur des ponts et au détriment des murs. Par une incroyable ironie de l’Histoire, on voit celle-ci nous offrir une séquence qui commence par l’effondrement du mur de Berlin et la fin de la séquestration des peuples par les dictatures communistes, et qui se termine sans doute en ce moment même avec le rétablissement des frontières. Cette fois, il s’agit moins d’empêcher les nationaux de sortir que d’empêcher les étrangers de rentrer. La Hongrie, la première à avoir levé le rideau de fer du bloc soviétique, a été la première à baisser la barrière devant l’invasion migratoire. La Grèce ferme sa frontière avec la Turquie pour la même raison. Enchaîné à l’utopie européenne, M. Macron, face à l’invasion virale, avait éloigné cette option de la fermeture aux limites de l’Union Européenne. L’Allemagne a répondu en fermant sa frontière avec la France ! Le virus n’avait pas besoin de passeport selon le chef de l’Etat français… Mais les personnes qui portent le virus avec elles en ont besoin. Le réalisme allemand a prévalu sur l’idéologie, l’égoïsme national aussi, puisque Berlin a interdit l’exportation du matériel sanitaire nécessaire à la lutte contre l’épidémie. L’inutilité de l’Union Européenne, face aux menaces, devient criante. Lorsque l’épidémie arrive, elle reçoit Greta Thunberg !
Les communautés réelles, la famille, la nation, dénoncées comme des antiquités pernicieuses par le progressisme et sa volonté de réduire l’humanité à une poussière d’individus nomades et interchangeables, reviennent en force, car elles sont les deux cercles les plus nécessaires de la solidarité. Le premier dessine l’espace de l’entraide de proximité entre les générations. Le second, celui de l’action salutaire de l’Etat en temps de crise pour prendre les mesures d’interdictions, d’obligations, de dotation en moyens humains, matériels et financiers destinées à faire face aux risques, sanitaire d’abord, économique ensuite. La déconstruction de la famille traditionnelle et de l’Etat national souverain sont suicidaires. Car ils sont les recours les plus efficaces lorsque le drame collectif survient. Mais pour qu’il y ait un Etat-Nation, il faut bien sûr qu’il y ait un Etat, un Etat non pas obèse, croulant sous les dépenses inutiles, mais musclé et concentré sur sa mission essentielle : la protection de SES citoyens, de l’armée à l’hôpital en passant par la police et la justice. Mais il faut aussi qu’il y ait une nation, c’est-à-dire une communauté d’hommes et de femmes partageant la même culture et conscients de leur destin solidaire, communiant dans une même identité nationale. La discipline des asiatiques, y compris dans un cadre démocratique, comme en Corée du Sud ou au Japon, a été un frein puissant à la propagation du mal. Les images saisies dans certains de nos quartiers montrent que nous en sommes loin.
La discrimination était le mot maudit par excellence. L’égalité était sacrée. Face à la maladie, la discrimination s’impose. Elle peut même prendre le masque horrible de la sélection entre ceux que l’on va faire vivre et ceux que l’on va laisser mourir, parce que l’offre de soins se sera raréfiée. Mais déjà des hiérarchies sont établies entre les activités et les personnes, entre celles qui sont indispensables et celles qui le sont moins, entre celles qui courent ou font courir plus ou moins de risques. La vie est une succession de choix. Il n’y a pas de place pour le « en même temps » illusoire. Les atermoiements, les démarches contradictoires, les déclarations ambivalentes du Président de la République signent le désastre de cette attitude irresponsable : un Président ne va pas inaugurer un café, même tenu par des handicapés, pour le faire fermer comme tous les autres quelques jours plus tard. Tenue et distance sont de retour. On s’était habitué à s’embrasser pour un oui, pour un non, comme l’ancien président de la commission européenne, M. Juncker. La sécurité sanitaire oblige désormais à retenir ces débordement hypocrites. L’amour, l’amitié, la compassion, la sympathie demandent des actes et non des signes ostentatoires. Authenticité et dignité y gagneront.
Au-delà de ces retours positifs, il en est d’autres qui le sont moins. L’obligation de porter sur soi une attestation pour ses déplacements, la pénurie de certains produits dans les commerces et les pharmacies ne sont pas sans évoquer les « ausweis » et les rationnements des « heures sombres ». Si hier était sympathique par certains côtés, avant-hier était épouvantable. La restriction de la liberté d’aller et de venir, ou de consommer, déjà présente dans l’idéologie verte, ne doit pas devenir une morne habitude. La liberté repose sur la possibilité d’effectuer des choix rationnels. Elle ne peut survivre dans un monde où la surveillance et le contrôle s’imposent au quotidien.
C’est l’atterrissage après la crise qu’il faudra réussir. En 2008, celle-ci était économique, fondée sur l’endettement, en premier lieu celui des nouveaux propriétaires américains. Néanmoins, les pompiers pyromanes qui nous gouvernent ont continué à fabriquer de la monnaie, et accentuent en ce moment même l’endettement des Etats, le nôtre en particulier. Il y a donc un risque de revenir, une fois l’épidémie jugulée, au monde d’avant, celui de l’imprévision et de l’insouciance, parlant du réchauffement climatique, parce que c’est la mode, mais oubliant de préparer des guerres plus proches et plus redoutables.
Demain, c’est cet équilibre entre la rigueur retrouvée et la liberté sauvegardée qu’il faudra reconstruire, c’est le retour vers le bon sens qu’il faudra mettre en œuvre.