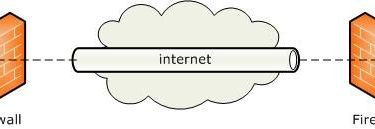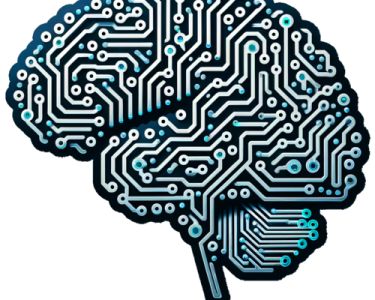Le « Brexit », c’est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, ne met pas seulement en cause le cadre politique, juridique et économique, des relations entre la Grand-Bretagne et l’Irlande du nord, d’un côté, et l’UE, de l’autre. C’est la plaie ouverte d’une fracture plus profonde et plus générale dans la plupart des Etats occidentaux, celle qui fragilise la démocratie qui semblait être devenue le régime incontournable de ces pays. Depuis 1945, le mouvement paraissait inéluctable en Europe : établissement ou rétablissement de la démocratie dans les pays libérés du nazisme ou du fascisme, puis dans les années 1970, disparition des dictatures « de droite », enfin, effondrement du bloc communiste. A chaque fois, l’élargissement de la communauté européenne accompagnait ce mouvement. Parallèlement, traité après traité, mais sans couvrir l’ensemble de l’Union, l’approfondissement accentuait le caractère technocratique d’une Europe dont les peuples subissaient une limitation de leur souveraineté. La cure d’austérité imposée après la crise de 2008 dont la Grèce a été la principale victime a mis en relief la perte de pouvoir d’un peuple face aux règles imposées par l’oligarchie bruxelloise et mondialiste. Avant de démissionner, le Premier Ministre socialiste grec avait du renoncer à un référendum sous la pression de la « Troïka », la Commission, la BCE et le FMI. L’extrême-gauche de Syriza parvenue au pouvoir, avec Alexis Tsipras et associée paradoxalement à un petit parti souverainiste de droite, les « Grecs Indépendants, pour assurer sa majorité, s’est, depuis, contentée d’obéir aux injonctions de Bruxelles et du FMI. Plus récemment, c’est une alliance également étrange qui a pris le pouvoir en Italie avec le mouvement 5 Etoiles et la Ligue. Le point commun réside dans l’effondrement des partis qui assuraient l’alternance droite-gauche au profit de formations « anti-système ». Toutefois, pour l’instant, en Grèce, c’est le système qui gagne, comme si les électeurs ne comptaient pour rien.
Les méandres du Brexit, qui, après des négociations difficiles entre un gouvernement issu d’élections et des apparatchiks bruxellois, paraissent conduire à un enlisement dans une crise parlementaire, révèlent une remise en cause encore plus grave de la démocratie sous ses différentes formes. La démocratie directe du référendum est attaquée de deux côtés : on prétend en limiter les effets, voire en rendre les conséquences si complexes qu’elles obligeraient à y renoncer ; par ailleurs, le vote populaire est délégitimé car les électeurs semblent incapables de voter intelligemment. La démocratie représentative est aussi mise à mal : le parlement, en l’occurrence, le plus vieux du monde et le plus solide, ternit son image dans une série de votes qui devient ubuesque. Une conclusion pourrait surgir : les électeurs sont inaptes à trancher sur des sujets techniques, et leurs élus sont impuissants à transformer l’essai du vote populaire. Démocratie directe et démocratie représentative sont ainsi toutes deux discréditées. Une aube bien grise se lève : il faut laisser décider et agir les gens sérieux, ne pas tenir compte des opinions versatiles et encore moins des mouvements populaires, pour que la marche inéluctable du « progrès » advienne, sous la houlette de techniciens du pouvoir, que leur compétence supposée placera au-dessus de l’élection.
Nombreux sont ceux qui voient dans la construction européenne, pour le revendiquer ou pour le dénoncer, une démarche de « despotisme éclairé ». Ce ne sont pas les électeurs, ce ne sont pas les peuples qui la mettent en oeuvre, ce sont les banquiers, les professeurs et les fonctionnaires, qui vont être capables d’édifier le cadre institutionnel supranational, en appliquant les lois de l’économie, et en respectant les principes du droit, qui limitent a priori la volonté irresponsable des peuples. Pour les avocats de ce nouveau despotisme salutaire, dès lors que la sécurité et le niveau de vie sont assurés pour la majorité des gouvernés, le but est atteint, et la preuve est apportée que seuls des spécialistes de la gouvernance pouvaient y parvenir. Ainsi la Grèce est tirée d’affaire. La croissance est revenue, le chômage est tombé en-dessous de 20%. le tourisme prospère…. mais 350 000 Grecs ont quitté le pays, des dizaines de milliers d’entreprises ont fait faillite, le revenu des ménages a baissé d’un tiers, et la dette publique atteint 180% du PIB. Le malade est mort guéri, puisque la Grèce, obligée de vendre tous ses bijoux de famille, n’est plus que l’ombre d’elle-même, privée de toute souveraineté.
Pour ses accusateurs, cette évolution, cet effacement de la démocratie n’a rien d’inévitable. Comme toute conduite collective, celle-ci est déterminée par une pensée sous-jacente, en l’occurrence par une idéologie, celle du progrès, vu sous ses deux aspects : progrès de l’économie par la mondialisation des échanges, progrès du droit, par l’accroissement des libertés individuelles. L’Europe est bercée dans un sommeil mortel par ces deux chansons : sa population vieillit, et se trouve peu à peu remplacée au nom des besoins économiques, par des populations qui ne partagent pas les mêmes valeurs et affaiblissent sa sécurité. Sa puissance économique de plus en plus fondée sur la consommation va se réduire par rapport aux autres continents au fur et à mesure de leurs progrès technologiques. Les inégalités entre les nations européennes et à l’intérieur de chacune vont s’accroître. Le fossé va s’élargir entre l’élite mondialisée et les populations périphériques. La construction européenne est une machine à jeter les peuples avec l’eau de la démocratie. C’est aux peuples d’arrêter courageusement le processus, et ce mouvement de survie s’appelle le populisme.