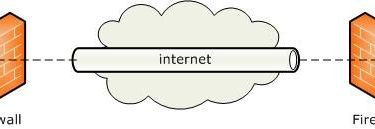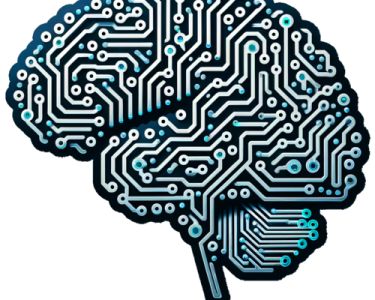Difficile de prévoir ce qui restera du mouvement des gilets jaunes. Au-delà des mécontentements quant au pouvoir d’achat, on entend donc souvent parler, à tort et à travers, d’une éventuelle Sixième république. S’agissant d’une plus grande place accordée à la pratique du référendum, idée centrale, qualifiée de populiste, et associée à un mouvement de gueux, on doit, certes, écarter les solutions creuses et illusoires. Le diable se nichant toujours dans les détails, on doit se garder des chemins conduisant à la tyrannie. Ils s’offriraient très vite à la naïveté des concepteurs. Par exemple, si l’on acceptait de faire voter un impôt par ceux qui ne le payeront pas.
Difficile de prévoir ce qui restera du mouvement des gilets jaunes. Au-delà des mécontentements quant au pouvoir d’achat, on entend donc souvent parler, à tort et à travers, d’une éventuelle Sixième république. S’agissant d’une plus grande place accordée à la pratique du référendum, idée centrale, qualifiée de populiste, et associée à un mouvement de gueux, on doit, certes, écarter les solutions creuses et illusoires. Le diable se nichant toujours dans les détails, on doit se garder des chemins conduisant à la tyrannie. Ils s’offriraient très vite à la naïveté des concepteurs. Par exemple, si l’on acceptait de faire voter un impôt par ceux qui ne le payeront pas.
La question essentielle tournera, aussi, autour de la taille du pays, de sa nature centralisée ou fédérale, et, au bout du compte du nombre des pétitionnaires.
Dans l’heureuse et courageuse principauté du Liechtenstein 1 000 signatures de citoyens, récoltées en 30 jours, suffisent à la mise en place d’une votation.
En Suisse il en faut 100 000, rassemblées en moins de 18 mois. L’acceptation d’un projet requiert alors la double majorité des votes du peuple et des cantons.
En Italie, il faut que la proposition soit soutenue par 500 000 électeurs.
En France, une réforme avortée a été mise place par Sarkozy en 2008. On appelle cela, parfois, de manière arbitraire, référendum d’initiative partagée : à l’article 11 de la Constitution de 1958, ont été ajoutés les alinéas 3 à 6 : “un référendum (…) peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales”.
Autrement dit, pour fonctionner, un tel dispositif requiert à peu près 10 fois plus de signataires qu’en Italie, adossés, pour bien border le mécanisme, à plus de 185 parlementaires sur les 348 sénateurs et 577 députés.
Il faut également que la proposition “porte sur un objet mentionné au premier alinéa” soit “sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.” Ouf.
Depuis 10 ans qu’il existe, sur le papier, un tel mécanisme n’a jamais été mis en œuvre.
Les partisans d’une démocratie plus honnête et plus directe semblent donc fondés à réclamer, tout simplement, l’allègement des conditions du processus. On pourrait dès lors s’aligner sur l’Italie, pays de taille et de culture comparables.
Ceci ne saurait être conçu comme une attaque “populiste” contre le pouvoir du peuple, encore moins contre les libertés, mais au contraire comme une réponse au caractère décadentiel de notre régime politique dans lequel les Français ne se reconnaissent plus.
Dans notre pays, en effet, les appareils des partis ont repris, de longue date, le dessus au sein de la représentation nationale. À partir de 1988, et des lois qui s’étalèrent jusqu’en 1995, le financement de la vie politique, loin d’être assainie, s’est trouvé parfaitement perverti. Les trésoreries sont alimentées par des mécanismes de subvention et des apparences hypocrites de contrôle financier.
S’il existait une véritable force d’opposition, à moins courte vue, on pourrait entendre d’autres propositions. On se préoccuperait de rétablir une authentique démocratie représentative. On se souviendrait que depuis le XIIIe siècle en Angleterre, et en France à partir de la Grande Ordonnance votée par les États Généraux de 1355, le bon sens impose un principe fondamental : l’impossibilité d’une taxation sans représentation des contribuables. Ceci fut accepté pendant tout l’Ancien Régime, et provoqua même le fin de la monarchie absolue, quand Louis XVI crut devoir[1] recourir aux États en 1789.
Aujourd’hui la démocratie représentative se voit entravée, bafouée, autant dans son appellation démocratique que dans sa légitimité représentative.
Ce régime théoriquement encore parlementaire est parvenu à un abaissement du pouvoir législatif que même les chambres du Consulat, de l’Empire ou des Cent jours n’ont pas subi. Et le dernier refuge sénatorial se bat, pied à pied, le dos au mur, défendant les lambris du palais du Luxembourg.
Pendant ce temps une part substantielle de l’opinion publique se berce d’un goût certain pour la tyrannie[2] et trouve tout à fait logique de penser le rôle du chef de l’État en termes de “pouvoir suprême”. On peut employer cette expression dans le cas d’un émule de Basam Dandu, éphémère empereur du Tibet[3]. On ne l’entendait pas entre 1958 et 1969, date du départ de ce général dont le costume constitutionnel avait été si religieusement taillé sur mesures dans l’atelier de Michel Debré et de René Capitant.
> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog L’Insolent.
Apostilles :
[1] Paradoxe historique rarement évoqué : on dit que la royauté française était alors surendettée, alors que l’Angleterre, après la guerre d’Indépendance américaine l’était encore plus.
[2] cf. article de votre serviteur publié dans “L’Incorrect” n°15 de décembre 2018, disponible dans tous les bons kiosques.
[3] cf. Le Secret de l’Espadon tome Ier.:)