Au premier chapitre de L’Empire du bien, Philippe Muray nous propose de plonger dans cet empire, avant de tenter de le fissurer, de l’éreinter : « Pour expliquer notre fin de siècle, il faut d’abord la visiter, se laisser porter par les courants, ne pas avoir peur des cohues, applaudir avec les loups, se mettre à l’unisson des euphories ». Franchir ce pas ne se fait pas sans courage. Pour quiconque a depuis longtemps fait sécession, s’est refusé à la grande parade imposée, a préféré le recours aux forêts au grand cirque de nos pseudo-démocraties, une telle décision peut d’ailleurs faire froid dans le dos.
C’est pourtant bien la tâche du romancier, telle que le même Muray l’a développée dans ses Exorcismes spirituels. Tâche bien plus digne et grave que ne pourraient nous le faire croire Messieurs Musso et Lévy ou Mesdames Pancol et Nothomb. Il n’est pas indifférent que Balzac soit le grand maître de Muray. Ce dernier a donc accepté avec courage – ne pensons pas un seul instant qu’un esprit aussi fin y ait trouvé un quelconque plaisir – de plonger les mains dans les tripes et la cervelles de la Bête cordicole.
Il a donc écouté les émissions des « grandes » radios nationales, publiques comme privées ; il a du subir la lecture des articles de Libération, du Monde et du Figaro ; il a prêté une oreille et un regard attentifs à toutes les grandes orgies du Bien : les prides, les fêtes des voisins, du sport ou du métissage, les grandes messes de l’ingérence humanitaire ; les mises en scène de la Culture officielle : biennales d’art contemporain, fête de la musique, « installations » conceptuelles.
Allant plus loin, plus profondément dans cette terrible machine à broyer ce qui restait de vraie vie dans notre modernité décadente, il s’est penché sur l’homme qui en naissait. Sur cet amas de cellules, mi-homme, mi-robot, en tout cas bien abruti. Cet adulescent permanent, esclave heureux de l’hyperconnexion, de la consommation efreinée et du sexe formaté. Cet individu hors-sol et hors-sang. Qui n’est plus rattaché ni à ses racines charnelles ni au continuum historico-philisophique qui faisait la spécificité de l’homme européen durant des millénaires.
En actualisant de quelques années l’analyse de Muray, le portrait-robot de ce sujet de l’empire du Bien n’est pas très difficile à décrire. Il participe à toutes les liesses collectives (il serait bien impropre de dire populaires puisque le peuple a depuis longtemps disparu). N’ayant plus aucune culture de référence pour analyser le réel, il se réjouit pourtant d’avoir « accès à l’information » que lui distillent les médias aux ordres de l’oligarchie. Vivant dans la sur-consommation permanente, y compris sur le champ culturel et spirituel, il vibre aux slogans du commerce équitable et du charity business. Etalant sur tous les fronts sa fierté d’assumer une liberté sexuelle si durement acquise, il n’aperçoit même plus ce que sa vie sexuelle a de médical, de technique, de perpétuellement pschychanalytique, le sexe lui, ayant depuis longtemps disparu. Incapable de répondre à l’appel des solidarités traditionnelles (familiales, amicales, locales), le cordicole se sent pourtant un amour infini pour son prochain, surtout si ce dernier est exotique.
Nous le voyons vite, l’analyse de Muray reste, à l’approche de 2014, particulièrement vive. Ses axes de tir, d’attaque, de mise à nue du profond ridicule de la modernité sont tellement variés que l’on pourrait presque conclure à l’exhaustivité. Lire Muray un crayon à la main est un exercice rapidement épuisant, tant les bons mots, les justes critiques, les paragraphes sanglants sont nombreux. Noël approche, offrez une cartouche aux pauvres petits soldats de l’anti-modernité, un livre à garder au chaud lorsque l’on s’enfonce dans les sombres forêts hivernales.
> L’Empire du bien de Philippe Muray, Les Belles Lettres, 1998


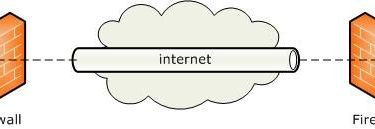
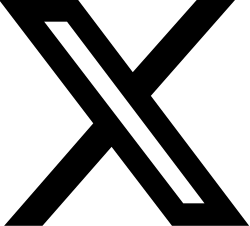

8 Comments
Comments are closed.