par Flore Durand
 L’État ne peut pas être un actionnaire comme les autres car son intervention n’est pas seulement fondée sur des considérations économiques ni patrimoniales. Ces interférences politiques contribuent à perturber l’équilibre déjà « très politique » de la gouvernance des entreprises.
L’État ne peut pas être un actionnaire comme les autres car son intervention n’est pas seulement fondée sur des considérations économiques ni patrimoniales. Ces interférences politiques contribuent à perturber l’équilibre déjà « très politique » de la gouvernance des entreprises.
C’est un peu une exception culturelle française : dans notre pays, l’État est très présent au capital des sociétés privées… Et ne se prive pas, même s’il n’en est pas l’actionnaire majoritaire, d’interférer dans la gouvernance de ces entreprises. Via l’Agence des participations de l’État (APE), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ou BPI France, la puissance publique est ainsi au tour de table de quelque 1 800 entreprises, employant au total 2,4 millions de salariés – soit 10 % de l’emploi salarié en France.
Les participations dans les 81 entreprises suivies par l’APE représentent au 30 juin 2017 un actif d’environ 100 milliards d’euros, dont plus de 66 milliards pour les seules entreprises cotées. Les entreprises du périmètre de l’APE rassemblaient un effectif d’environ 1,8 million d’emplois en 2016 – soit 7 % de l’emploi. Un portefeuille hétérogène, comprenant des participations dans des secteurs stratégiques comme l’énergie (Areva, EDF, Engie, Eramet) ou l’aéronautique et la défense (Airbus, Safran, Thales), mais aussi dans l’automobile (Renault, PSA), les télécoms (Orange), les services (CNP, Dexia, La Poste), les transports (RATP, SNCF), y compris aériens (Air France-KLM), les aéroports (ADP) et les ports… Des participations tantôt majoritaires, tantôt minoritaires, mais souvent significatives.
« L’État peine à être un bon actionnaire »
Problème : malgré les progrès réalisés depuis la création de l’APE en 2004, « l’État peine à être un bon actionnaire » car il est « à la fois trop présent dans la gestion et trop peu vigilant comme actionnaire », estime la Cour des comptes dans un rapport sur le sujet publié en janvier 2017. Une analyse qui dresse un bilan sans concession des participations de l’État dans les entreprises entre 2010 et 2016.
Non seulement le portefeuille de l’État est, selon les Sages, dans une « situation financière préoccupante » suite aux difficultés rencontrées par la SNCF, EDF et Areva, mais l’État actionnaire va aussi devoir débourser à l’avenir sept milliards d’euros pour recapitaliser EDF et Areva. Des problèmes patrimoniaux qui, selon la Cour des comptes, découlent directement de la façon dont l’État gère ses participations, « conciliant des objectifs nombreux et souvent contradictoires ».
Car l’État n’est jamais seulement actionnaire, il est aussi, tour à tour, gestionnaire de finances publiques, régulateur, porteur de politiques publiques, et même parfois client. Une multiplicité de personnalités qui ne favorise pas la focalisation sur la rationalité économique et l’intérêt social des entreprises. La vision de l’État actionnaire passe en effet souvent après les intérêts de « l’État régulateur » et surtout de « l’État politique ». Les impératifs économiques sont alors en concurrence avec d’autres considérations : opposition syndicale, risque social, contrainte environnementale… Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, les différents gouvernements ont ainsi préféré maintenir le plus bas possible les tarifs réglementés de l’électricité, au détriment de la rentabilité d’EDF.
« Sans stratégie de long terme, l’État agit fréquemment au détriment des intérêts économiques du groupe et de son équilibre financier, aggravant son endettement », estime le rapport de la Cour des comptes, qui conseille donc à l’État de se concentrer sur des objectifs précis, « comme le sauvetage d’entreprises dont la défaillance emporterait des risques systémiques ou la protection d’entreprises présentant des intérêts essentiels pour la sécurité nationale ».
Un décalage temporel entre l’économique et le politique
« Les horloges des mondes politique et économique sont profondément désynchronisées », souligne de son côté l’Institut Montaigne dans une note publiée en janvier 2017 et signée par David Azéma, lui-même ancien directeur de l’Agence des participations de l’État. D’abord, le temps du politique et de l’administration est rythmé par les échéances électorales alors que celui des entreprises l’est par le cycle des résultats… Mais l’écart de perception le plus significatif tient au sentiment d’urgence lié au besoin de financement, vital pour les entreprises.
« Pour les sociétés cotées, le cours de l’action, mesuré de manière instantanée, constitue un indicateur permanent de la confiance des investisseurs et, en cas d’effondrement, un signal avant-coureur de graves difficultés de financement, avec des conséquences potentiellement fatales, explique David Azéma. Dans un tel contexte, les dirigeants d’entreprise ne peuvent différer des mesures qu’ils jugent nécessaires. Rien de tel dans l’Olympe des États les mieux notés de la planète. La ressource y apparaît comme inépuisable et, donc, le temps de l’action peut s’étirer à l’infini. La procrastination devient alors l’alpha et l’oméga de l’actionnaire public ». Une fâcheuse tendance à laisser traîner les choses qui a notamment contribué à précipiter la chute d’Areva. Même chose dans le cas des privatisations partielles possibles d’Aéroports de Paris (ADP) ou de la Française des Jeux (FDJ) : alors que les marchés financiers ne détestent rien moins que l’incertitude, le gouvernement a décidé de ne rien décider pour l’instant. Pourtant, l’État doit rapidement trouver plusieurs milliards d’euros manquants sur les 10 prévus pour alimenter le futur fonds pour l’innovation. De quoi s’interroger sur la stratégie de l’État qui, dans certains cas, n’aide clairement pas à la valorisation de certains de ses actifs.
Hésitations sur la gouvernance d’Engie
Aujourd’hui, ce type de tergiversations risquent de pénaliser Engie si l’incertitude concernant la future gouvernance du géant de l’énergie continue à se prolonger. Alors que tout le monde attendait logiquement la nomination de la directrice générale exécutive, Isabelle Kocher, au poste de PDG, après le départ Gérard Mestrallet de son poste de président du conseil d’administration en mai prochain, le journal Les Echos a révélé que les représentants de l’État auraient plutôt l’intention de maintenir une direction bicéphale et de nommer un nouveau président du conseil d’administration… Même si la décision finale appartiendrait au président de la République.
Dans cette attente, au moment où Engie est engagé dans un plan de transformation ambitieux, mené depuis deux ans avec succès par Isabelle Kocher, la communauté financière s’interroge : la finalisation de l’exécution de ce plan va-t-elle se dérouler dans de bonnes conditions si le leadership et la cohérence stratégique du management devaient être réduites par la nomination d’une nouvelle personnalité à la présidence du conseil d’administration ? Avec une direction bicéphale, le risque est en effet toujours présent que le nouveau tandem ainsi constitué par l’intervention politique ne puisse fonctionner de façon « fluide » et que d’éventuelles divergences de vues ou que certains conflits de périmètre puissent ralentir le processus de décision, alors que l’environnement du groupe change vite et en profondeur.
Plus cette incertitude dure et plus la valeur de l’action risque d’entrer dans une zone de turbulences. Une situation que personne ne peut souhaiter, et tout particulièrement l’État actionnaire, d’autant que celui-ci est engagé dans un programme de désengagement du capital d’Engie et devrait donc être particulièrement attentif à ce type de signaux, dans une logique actionnariale et patrimoniale, mais aussi en tant que gestionnaire de l’argent public.
L’exemple Dalkia ?
Dalkia, filiale d’EDF dédiée aux services énergétiques, n’a pas eu les hésitations que le gouvernement a dans le cas d’Engie : le conseil d’administration de Dalkia a décidé début janvier de « faire évoluer sa gouvernance en fusionnant les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général », a ainsi précisé la filiale d’EDF dans un communiqué. Il est vrai que la décision pouvait être prise en interne, sans interférence de l’exécutif. Mais l’exemple de cette filiale de la plus importante participation de l’État mérite considération : alors qu’EDF poursuit la réorganisation de certaines de ses filiales sous le giron de Dalkia, le CA décide de privilégier l’efficacité et la cohérence d’ensemble en nommant Sylvie Jéhanno PDG de la structure. Cette dernière est connue notamment pour son sens de la relation-client et de sa parfaite maîtrise de la partie technique, compte tenu d’un cursus Polytechnique-Mines. « Femme d’énergie, à tous les sens du terme », selon la description faite par le Figaro. Sylvie Jéhanno endosse en prime la présidence de Tiru, filiale de Dalkia spécialisée dans la production d’énergie à partir de déchets, aux côtés de Pierre de Montlivault, l’actuel directeur général. Devant l’exemple de Dalkia, qui n’hésite pas à confier simultanément les mandats de PDG de Dalkia et de présidente de Tiru à Sylvie Jéhanno, on comprend mal les réticences de l’Etat à se prononcer dans d’autres cas. Mais il est vrai que l’État n’est pas un actionnaire ordinaire.
Les interférences d’un actionnaire « pas comme les autres »
Ce domaine de la gouvernance des entreprises constitue, selon David Azéma, un très bel exemple des « contradictions de l’État actionnaire qui, in fine, affaiblissent à la fois l’État et l’entreprise ». Au total, l’État actionnaire participe à la nomination de 824 administrateurs siégeant actuellement aux conseils d’administration et de surveillance des entreprises, dont 240 administrateurs représentant l’État.
Les mandataires sociaux des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, y compris cotées, sont nommés en Conseil des ministres, après avis du Parlement, alors qu’il s’agit de postes de direction d’une société de droit privé. Cette pratique remet donc clairement en cause le pouvoir de nomination des dirigeants du conseil d’administration. Même dans les entreprises où l’Etat reste minoritaire, mais « actionnaire de référence », il peut peser de tout son poids pour imposer un mode de gouvernance, un PDG ou un président du conseil d’administration.
« Dans les organes de gouvernance, l’État n’est jamais vu comme un actionnaire normal et ses représentants au conseil se trouvent piégés entre deux regards : celui des autres administrateurs, qui voient dans les représentants de l’État des marionnettes aux ordres de politiques imprévisibles et n’ayant pas la légitimité requise, et celui des représentants du personnel, qui les interpellent sans cesse au motif que l’Etat devrait intégrer d’autres logiques que la seule recherche du profit », note ainsi David Azéma dans sa note signée pour l’Institut Montaigne.
En pratique, ces interférences perturbent « la construction du double consensus entre membres du conseil et entre conseil et management, qui est au cœur du bon fonctionnement des entreprises », estime l’ancien directeur de l’APE. « Les entreprises qui le subissent sont donc intrinsèquement plus fragiles et moins aptes à réagir à des situations difficiles ».



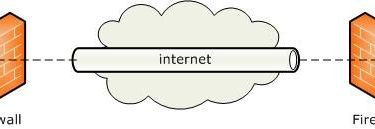
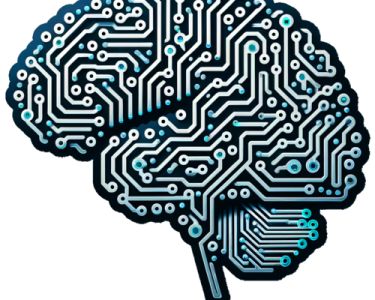
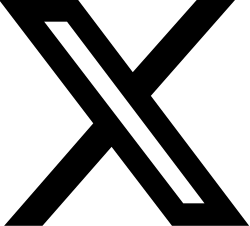
1 Comment
Comments are closed.