C’est au début des années 1980 que les autorités monétaires et financières ont commencé à imposer aux banques de respecter ce que nous appelons aujourd’hui des ratios de solvabilité (ou, indifféremment, des ratios d’adéquation des fonds propres). L’idée, comme toujours, partait des meilleures intentions qui soient : il était question d’empêcher les banques de prendre trop de risques en limitant la quantité de crédit qu’elles pouvaient accorder en fonction de leurs fonds propres. Aux États-Unis, par exemple, les premiers ratios de ce type (1981) imposaient aux banques de disposer d’un capital (1) égal à 5 ou 6% (en fonction du type de banque) du montant total de leurs actifs.
À partir du milieu de la décennie, il est apparu aux régulateurs que ces ratios basiques souffraient d’une faille importante dans la mesure où ils ne distinguaient pas les prêts réputés sûrs (accordés aux institutions publiques par exemple) de ceux dont on pouvait raisonnablement supposer qu’ils étaient plus risqués (typiquement, un prêt accordé à une entreprise privée dont la situation financière est fragile). Ce sont ces réflexions qui, en 1988, vont donner naissance au premier des ratios de Bâle (2), le ratio Cooke ou Bâle I. Le principe en est le suivant : les banques doivent désormais calculer le montant de leurs actifs pondérés des risques (y compris le hors-bilan) et faire en sorte de disposer d’un capital au moins égal à 8% de ce dernier.
Dans le cadre du ratio Cooke, le calcul de l’actif pondéré des risques se base sur quatre grandes catégories : les crédits accordés à (ou garantis par) des gouvernements sont pondérés à 0% (c’est-à-dire qu’un prêt de $100 au gouvernement des États-Unis compte pour 0% de $100, soit $0), les prêts aux banques sont pondérés à hauteur de 20% (3), les crédits immobiliers sont pondérés à 50% tandis que tous les autres types de prêts – et notamment les lignes de crédit accordées aux entreprises – sont pondérés à 100%. Par exemple, une banque qui aurait accordé $25 de prêts au gouvernement, $25 à une autre banque, $25 de crédits immobiliers et $25 à une entreprise afficherait un actif de $100, un actif pondéré des risques de $42,5 (0% x $25 + 20% * $25 + 50% * $25 + 100% * $25) et devrait donc disposer d’un capital de $3,4 (8% x $42,5).
“Pour les petites entreprises, la mise en œuvre des ratios de Bâle s’est traduite par un tarissement ou, dans le meilleur des cas, un renchérissement du crédit bancaire sans qu’aucune alternative viable ne vienne le remplacer.”
Pour les banques, qui, à l’instar de n’importe quelle entreprise privée, raisonnent en termes de rentabilité de leurs fonds propres, le message du législateur est on ne peut plus clair : moins de prêts aux entreprises et plus de crédit immobilier. Les chiffres de la Fed pour les États-Unis sont sans équivoque : d’environ 25% du total des crédits accordés par les banques en 1988, les crédits immobiliers ont littéralement explosés et représentent aujourd’hui plus de 40% du montant total prêté par les banques. Sur la même période, les crédits industriels et commerciaux ont suivi la tendance inverse : de 25% en 1988, ils pèsent aujourd’hui moins de 14% des prêts bancaires.
Les banques se montrant de plus en plus frileuses dès lors qu’il était question de leur prêter de l’argent, les entreprises ont dû trouver d’autres sources de financement. En l’occurrence, c’est vers les marchés qu’elles se sont retournées : elles se sont mises à émettre des obligations (ou, d’une manière plus générale, des titres de créances) qui leur permettaient de contourner l’industrie bancaire et d’accéder directement aux capacités de financement de l’économie. Ce phénomène porte un nom, la désintermédiation bancaire, et il a une limite : il ne concerne que les grandes entreprises. En effet, une émission obligataire, pour des raisons de coûts et de liquidité, ça se chiffre en centaines de millions d’euros. Pour les petites entreprises, la mise en œuvre des ratios de Bâle s’est donc traduite par un tarissement ou, dans le meilleur des cas, un renchérissement du crédit bancaire sans qu’aucune alternative viable ne vienne le remplacer.
Une autre stratégie de contournement des ratios de solvabilité a consisté, pour les banques, à se débarrasser massivement des risques de crédits qu’elles portaient sur leur bilan. La méthode, connue sous le nom de titrisation, consiste à transférer les crédits accordés par une banque à une entité créée pour l’occasion ; laquelle entité finance l’opération en émettant de la dette sur les marchés. En d’autres termes, les banques ont, pour pouvoir continuer à prêter tout en respectant la contrainte réglementaire, transféré leurs risques sur des institutions non-bancaires. Aux États-Unis, par exemple, le développement du marché des Asset-Backed Securities coïncide parfaitement avec la mise en œuvre de Bâle I.
“C’est la combinaison de ces deux effets – désintermédiation et titrisation – qui va donner naissance à ce que nous appelons aujourd’hui le shadow banking.”
C’est la combinaison de ces deux effets – désintermédiation et titrisation – qui va donner naissance à ce que nous appelons aujourd’hui le shadow banking (la « finance de l’ombre », brrr…) ; c’est-à-dire l’ensemble des activités qui, pour faire simple, prêtent de l’argent sans recevoir de dépôts et ne sont donc, à ce titre, pas soumises aux ratios de Bâle. On y inclut généralement les banques d’affaires, les fonds d’investissement (du fonds monétaire au hedge fund), les compagnies d’assurance, les organismes de crédit non-bancaires, les véhicules de titrisation… Bref, les entités qui sont venue se substituer aux banques pour financer l’économie.
Enfin, à la toute fin des années 1990, le comité de Bâle propose une réforme du ratio dont la principale caractéristique est l’introduction des notes des agences de notation financière (4) dans le calcul des actifs pondérés des risques. C’est le ratio McDonough ou Bâle II. Là encore, la démarche du législateur est parfaitement logique : comment justifier, en effet, qu’un prêt à une banque qui connaît de graves difficultés financière soit pondéré plus faiblement qu’un crédit accordé à une entreprise en bonne santé ? Petit à petit, au cours de la deuxième moitié des années 2000, ce nouveau principe est adopté et va même faire des émules dans d’autres règlementations – typiquement Solvabilité II pour les compagnies d’assurances.
Cette idée qui consiste à intégrer les notes des agences dans la règlementation n’est en réalité pas nouvelle ; elle est même antérieure aux premiers ratios de solvabilité bancaire puisque, dès 1975, la Securities and Exchange Commission avait appliqué ce principe aux courtiers étasuniens. Naturellement, pour les agences de notation officiellement adoubées par le législateur (5), c’est une excellente nouvelle puisque ne pas être noté par l’une d’entre elles se traduit, pour la plupart des emprunteurs, par un surcoût qui excède très largement celui de la notation elle-même. Sans surprise, c’est donc à partir de 1975 que les agences ont pris la détestable habitude de se faire rémunérer par les emprunteurs dont elles étaient chargées d’évaluer la solidité financière.
“La généralisation des règlementations de type Bâle II va avoir principalement deux conséquences sur les affaires des agences : d’une part, elles disposent désormais d’une rente règlementaire qui leur assure de confortables bénéfices et, par ailleurs, elles vont acquérir un pouvoir d’influence sans précédent.”
La généralisation des règlementations de type Bâle II va avoir principalement deux conséquences sur les affaires des agences : d’une part, elles disposent désormais d’une rente règlementaire qui leur assure de confortables bénéfices et, par ailleurs, elles vont acquérir un pouvoir d’influence sans précédent. Autrefois, une banque ou un investisseur pouvait choisir d’ignorer les conseils des agences ; désormais, la dégradation d’une note a des conséquences légales. Aujourd’hui, lorsque les agences dégradent un emprunteur en deçà d’un certain seuil, ce sont ces contraintes règlementaires qui forcent les investisseurs à vendre et, pire encore, à vendre tous en même temps.
Quelles que soient vos opinions politiques, il y a donc un certain nombre de faits auxquels vous ne pouvez pas échapper.
Primo, l’industrie bancaire, loin d’être, comme on l’entend trop souvent « dérégulée », a subit au contraire un large mouvement de régulation depuis, en gros, le début des années 1980. C’est même la seule industrie qui est aujourd’hui régulée de manière coordonnée à l’échelle mondiale ; les ratios de solvabilité n’étant qu’une des nombreuses pierres de l’édifice. Le fait est que ces derniers, qui visaient précisément à limiter les risques de faillite et les paniques bancaires, se sont révélés parfaitement inopérants. Vous pouvez estimer que le législateur a mal fait son travail, qu’il a été trop laxiste mais mettre la crise que nous traversons sur le dos d’une prétendue absence de régulation relève de l’ignorance ou de la malhonnêteté intellectuelle.
Deuxio, les ratios de solvabilité ont bien eu des effets et pas des moindres : ils ont provoqué, d’une part, la désintermédiation bancaire et le développement du shadow banking et, d’autre part, l’explosion du marché de la titrisation. Nos politiciens qui, aujourd’hui, se plaignent de ce que les banques ne prêtent plus aux entreprises (d’où la Banque publique d’investissement) et s’inquiètent de l’importance du shadow banking ne semblent pas réaliser que ce sont précisément leurs interventions passées qui sont à l’origine de ces phénomènes. Si le durcissement des ratios de solvabilité bancaires (Bâle III) et la « reprise en main » des sources de financement non-bancaires de l’économie doivent avoir un effet, c’est bien de réduire encore un peu plus les sources de financement à la disposition nos entreprises.
“Aujourd’hui, lorsque les agences dégradent un emprunteur en deçà d’un certain seuil, ce sont ces contraintes règlementaires qui forcent les investisseurs à vendre et, pire encore, à vendre tous en même temps.”
Tertio et symétriquement, vous ne pouvez pas, en conscience, nier le fait que les ratios de solvabilité ont très largement favorisé les crédits immobiliers et les emprunts publics qui se trouvent précisément être au cœur de la crise que nous connaissons aujourd’hui. Ce n’est, bien sûr, qu’une partie de l’équation mais nier le rôle joué par la règlementation dans la croissance des crédits immobiliers et donc, dans la formation de la bulle immobilière relève de l’aveuglement pur et simple.
Quarto et j’en resterai là : c’est le législateur qui, en utilisant les notes des agences dans la réglementation, a introduit un risque systématique massif dans notre système financier. Là où, autrefois, banquiers et investisseurs pouvaient décider de continuer à soutenir un débiteur en difficulté, ils n’ont désormais plus le choix : il leur faut vendre et il leur faut vendre tous en même temps. Ces problèmes que sont le pouvoir exorbitant acquis par les agences et ses conséquences sur les emprunteurs qui voient leur note dégradée ne seront pas réglés en légiférant : ce sont justement des conséquences directes et logiques de la réglementation.
C’est un principe bien établi : chaque catastrophe provoquée par l’ardeur législative de nos gouvernants est immédiatement requalifiée en « défaillance du marché » qu’il faut, de toute urgence, colmater à coup de réglementations. Nous allons donc assister à un nouvel épisode dont la fin est, malheureusement, déjà connue. Puissions-nous enfin en tirer les conclusions qui s’imposent.
> le blog de Georges Kaplan (Guillaume Nicoulaud)
—
1. Primary capital, principalement composé des fonds propres et des réserves.
2. Du nom de la ville suisse dans laquelle se réunissent, sous l’égide de la Banque des règlements internationaux (BRI), les gouverneurs des banques centrales du G10 (a.k.a. le comité de Bâle).
3. C’est aussi le cas, aux États-Unis, des prêts accordés aux government-sponsored enterprises comme Fannie Mae et Freddie Mac.
4. En pratique, les banques qui en ont les moyens peuvent opter pour des méthodes internes d’évaluation des risques. Naturellement, ces dernières sont soumises à l’accord des autorités de tutelles qui veillent à ce qu’elles ne s’écartent pas trop des modèles de référence – c’est-à-dire ceux des agences.
5. Aux États-Unis, les Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO).


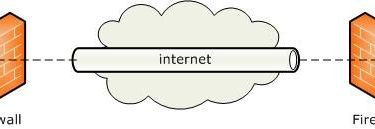
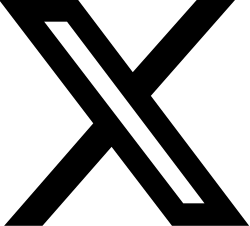

26 Comments
Comments are closed.