Le discours de Leipzig en a surpris plus d’un : « François Hollande se prend pour Gerhard Schröder » a titré La Nouvelle Lettre la semaine dernière. Parmi les commentaires, voici celui de Jean-Vincent Placé, Président du groupe Vert au Sénat, précisant que « la politique de l’offre » du Président Hollande « était un échec ». Notre confrère Les Échos n’avait-il pas écrit quelques jours plus tôt : « Le chef de l’État assume clairement une politique de soutien à l’offre » ? Double méprise : d’une part, un discours n’engage que ceux qui l’écoutent, d’autre part, la politique actuelle est keynésienne et colbertiste. Pour mesurer tout ce qui sépare François Hollande d’une politique de l’offre, je rappelle les trois piliers de cette politique : défiscaliser, déréglementer et désétatiser. Et c’est bien de cela dont nous aurions besoin.
Politique de la demande contre politique de l’offre
L’une est keynésienne, l’autre libérale. Entre les deux, il existe des différences majeures. La première est macroéconomique et vise à manipuler quelques grandeurs globales un peu comme un technicien manœuvrant quelques manettes : l’État omniscient agit sur ces manettes à contre-courant, freinant quand l’économie est en surchauffe, accélérant lorsqu’elle ralentit. L’économie serait une machine dont les rouages obéissent au doigt et à l’œil. Dormez citoyens, l’État agit pour vous. Présomption fatale aussi.
Les politiques libérales de l’offre visent au contraire à encourager les agents décentralisés, en les libérant de leurs chaînes fiscales, sociales, réglementaires : elle est microéconomique, faisant confiance à la capacité d’action et d’imagination des entreprises et des ménages, du moment qu’on les laisse faire : « Laissez faire, laissez passer », c’est le principe de toute politique libérale. Une véritable économie de marché n’a pas besoin de politique économique. Mais voilà des lustres que nous ne sommes plus dans une vraie économie de marché et la politique libérale consiste à y revenir.
Une autre différence majeure : pour Keynes, le moteur de l’économie c’est la dépense. En cas de récession on stimule la demande, en cas d’inflation on la freine. Mais d’où vient l’argent que l’on dépense ? Pour les libéraux, le moteur de l’économie c’est l’offre, c’est-à-dire la production de biens et services susceptibles d’être approuvés par le marché. La loi de Say doit être comprise ainsi : « l’offre crée sa propre demande ». Autrement dit, le pouvoir d’achat qui permet de dépenser ne peut avoir pour origine que les recettes des entreprises, c’est-à-dire la rémunération du travailleur, de l’épargnant et de l’entrepreneur qui ont contribué à créer la valeur de ces produits. Il n’y a pas de politique économique libérale au sens strict du terme, puisque les mesures proposées ne sont ici que libération des initiatives privées.
Macroéconomie et manipulation de la demande
La politique du Président Hollande est donc fondamentalement keynésienne, agissant du sommet, en manipulant les manettes à la disposition de l’Etat, et elle est macroéconomique. L’ampleur des déficits publics, de l’ordre de 4% du PIB, surtout avec le « sursis » de deux ans pour parvenir aux 3%, signifie que les dépenses publiques sont supérieures aux recettes, ce qui est le B.A BA d’une politique de relance de la demande. Dire que le déficit est un peu réduit – ce qui restera à démontrer avec le sursis accordé – n’enlève rien au fait que la demande publique reste au cœur du dispositif. En outre, le keynésianisme repose sur l’idée que la dépense publique est plus efficace que la dépense privée ; quand on arrive à 56% du PIB en dépenses publiques, c’est qu’on croit à leur magie !
“Il n’y a pas de politique économique libérale au sens strict du terme, puisque les mesures proposées ne sont ici que libération des initiatives privées.”
Défiscaliser ?
La défiscalisation est la mesure type de la libération économique : il doit y avoir moins d’impôts, pour développer l’incitation à produire, entreprendre, investir, travailler plus, etc.. L’impôt n’a pas seulement un impact sur la demande ; il a surtout un impact sur l’offre : plus le taux de l’impôt est élevé, plus l’incitation à produire se réduit ; le cœur d’une politique de l’offre consiste donc à réduire la progressivité de l’impôt, pour encourager ceux qui entreprennent le plus, et à réduire le poids des prélèvements obligatoires. Il faut être aveugle pour voir une défiscalisation dans la politique de François Hollande. Depuis un an on a enregistré un déluge d’impôts nouveaux et de hausses d’impôts existants, des prélèvements au plus haut (à 46% du PIB), l’impôt sur les sociétés le plus élevé d’Europe (33,33%), des tranches marginales en hausse, sans parler des diverses versions de l’imposition à 75%. Arthur Laffer n’a pas suggéré, pour libérer l’incitation à offrir plus, une hausse, mais une baisse des impôts ; nous assistons à l’inverse.
Déréglementer ?
Avec 400 000 textes et normes, la France est le pays le plus réglementé d’Europe. Notre code du travail est le plus épais. Le colbertisme est omniprésent dans tous les domaines, alliant régulation et centralisation.
Le gouvernement a-t-il pris la moindre mesure dans ce domaine ? On fait grand cas de la « flexibilité » introduite sur le marché du travail, au grand dam de la CGT. Un petit peu plus de souplesse rendue possible, dans certains cas, sur le temps de travail ou les salaires, cela n’a rien à voir avec une vraie déréglementation du marché du travail, qui passerait par la suppression de la durée légale du travail, par la flexibilité totale des salaires (et la suppression du SMIC), par la possibilité de licencier rapidement en cas de nécessité, condition nécessaire pour favoriser les embauches. Et le fameux « choc de compétitivité » consistant à transférer une partie des charges sociales sur d’autres prélèvements est surtout un tour de passe-passe. Parler « d’exigence de compétitivité » en augmentant les prélèvements, c’est original !
Au-delà du marché du travail, la déréglementation, ce serait la liberté totale des prix des biens et services (combien restent encore contrôlés !) et des prix des facteurs (y compris le taux d’intérêt) ; l’ouverture totale des services publics à la concurrence (alors qu’on ne parle que de les renforcer), l’ouverture totale des frontières, l’ouverture des professions fermées à la concurrence. Chaque jour le gouvernement sort de nouveaux textes régulant ici la finance, là les services, ailleurs l’industrie. Où est la simplification administrative annoncée ?
Désétatiser ?
La désétatisation enfin : le recul de l’État dans l’économie. Où est la désétatisation, quand les entreprises publiques le restent, et que l’on en a créées de nouvelles (voir la Banque publique d’investissement) ? Quand la protection sociale est totalement étatisée : retraites, Assurance maladie : où est la fin des monopoles publics dans ce domaine ? Quand les dépenses publiques dépassent largement la moitié du PIB ? Désétatiser, ce serait déplacer la frontière entre secteur privé et secteur public : privatiser dans tous les domaines, entreprises, école, protection sociale. Est-ce l’objectif du Président ?
La subversion commence par celle du vocabulaire. Le gouvernement pratique une politique keynésienne et étatiste, avec une hausse des impôts. Appeler cela une politique de l’offre, c’est retirer aux mots leur signification. Et c’est ajouter aux maux de notre économie les mots du mensonge.
Pour ne pas terminer sur une note trop pessimiste, je reconnais que si François Hollande devait être notre Gerhard Schröder, il aurait sans doute une tâche plus difficile, mais il aurait aussi le soutien de tous les libéraux, que l’on sait si nombreux en France !
> Cet article est publié en partenariat avec l’ALEPS


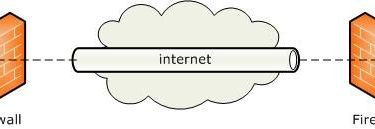
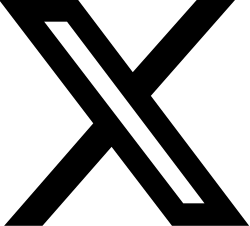

9 Comments
Comments are closed.