Pour venir à bout de la crise, déclara le Grand Prêtre, il faut élever un veau d’or au sommet de la butte Montmartre et inciter tous les français à en faire trois fois le tour.
De là, deux possibilités :
Si la croissance revient, on en conclura que la méthode fonctionne.
Si la croissance ne revient pas, on affirmera que c’eût été bien pire si nous n’avions rien fait (1) et on en conclura qu’il aurait fallu faire huit tours plutôt que quatre.
Une chose que nous ne ferons pas, en revanche, c’est remettre en cause l’efficacité de la méthode. Elle est bonne et ce point ne souffre pas de contradiction. On peut ergoter sur la taille du veau d’or, sur le nombre de tours à faire et même sur l’emplacement de l’idole mais remettre en cause la méthode elle-même n’est pas envisageable. On en a excommunié pour moins que ça.
Comme vous le savez certainement, pour relancer la demande et donc la croissance, il faut que l’État dépense plus qu’il ne perçoit – c’est-à-dire qu’il doit exécuter quelques budgets déficitaires et donc s’endetter. C’est la base de la théorie keynésienne (2) et c’est l’avis que partage l’immense majorité de nos politiciens (sinon tous) ainsi que les éminences grises qui écrivent leurs discours. Naturellement, le corollaire naturel de cette idée est que toute politique de réduction du déficit (sans aller, bien sûr, jusqu’à dégager des excédents (3)) est une politique d’austérité ou de rigueur ; et qu’une politique d’austérité ou de rigueur est nécessairement récessive.
Là-dessus, point de débat.
Il est en revanche permit de se demander comment, précisément, l’État doit dépenser l’argent ainsi emprunté. Certains expriment une préférence pour les grands travaux (construire des barrages ou des canons) ; d’autre préfèrent que l’on distribue cet argent via les systèmes d’aide sociale (les « stabilisateur automatiques » ou la conscription) ; les derniers, enfin, recommande un mélange des deux (un plan de relance ou une guerre). Après tout, peu importe la méthode, pourvu que le déficit des comptes publics soit important (et qu’on ait l’ivresse).
La référence absolue des partisans de la relance, c’est le New Deal de Franklin Roosevelt. De quelle ampleur fut cette mythique réussite ? C’est bien sûr très difficile à résumer en un chiffre mais – au regard de ce que nous avons écrit plus haut – nous allons tout de même le faire en utilisant le déficit budgétaire d’oncle Sam comme point de référence. De 1932 à 1937, donc, le New Deal s’est traduit par un déficit de 251 milliards de dollars de l’époque – soit une moyenne de 4,3% du Produit intérieur brut sur six ans.
Or voilà, même en faisant preuve d’un optimisme hollandien pour l’exercice en cours et le suivant, le déficit budgétaire de l’État français devrait attendre au bas mot 5% sur la période 2009-2014. C’est un minimum. Je ne suis même pas sûr qu’ils y croient. C’est-à-dire que, sauf miracle, la relance Sarkozy/Hollande aura très largement surpassé celle de Franklin Roosevelt.
Comme il semble que cela ne fonctionne pas, les spécialistes nous répètent que c’eût été bien pire si nous n’avions rien faire et qu’il suffit, pour obtenir les effets escomptés, de creuser encore un peu plus le déficit. De toute manière, comme disait ma grand-mère, après la pluie viendra le beau temps.
> le blog de Georges Kaplan (Guillaume Nicoulaud)
—
1. C’est un élément de philosophie Shadock (d’où le titre de ce papier) : il vaut mieux continuer à pomper même si cela ne produit rien de bon que risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas.
2. Du nom de John Maynard Keynes, son inventeur.
3. Sur ce point, les disciples de Keynes tendent étrangement à s’écarter des recommandations du maître.


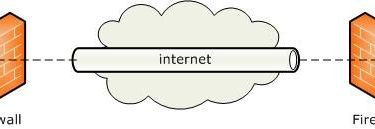
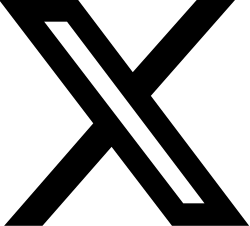

3 Comments
Comments are closed.