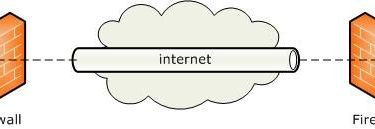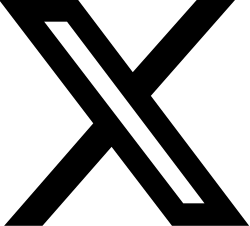Il faut prendre en compte les structures psychologiques provenant de notre nature animale. Un exemple avec le traumatisme post-avortement
Dans deux articles précédents (voir ici et là), j’ai essayé de montrer à quel point la négation des structures psychologiques et culturelles profondes issues de notre nature animale pouvait amener de graves conséquences.
Alors même que l’on prend de plus en plus conscience du caractère suicidaire de l’oubli de la réalité écologique face au progrès, et de la folie d’un développement technique aveugle qui ne respecte pas les équilibres naturels, il est très curieux que dans le même temps, on fasse précisément la même erreur dans le domaine de la sexualité humaine, comme si celle-ci n’avait rien de naturel.
Il ne fait de doute pour personne, pourtant, que si l’homme a la possibilité, par la raison, de ne pas être « gouverné par ses passions » et ses instincts, ceux-ci existent bel et bien, et influencent son comportement. Des tentatives avaient été faites autrefois pour expliquer scientifiquement comment tout cela fonctionne, notamment par le neurobiologiste Paul MacLean au cours des années 60, avec la théorie du « cerveau triunique », et l’existence de cerveaux « reptilien » et « paléomammalien » où seraient logés nos instincts « primaires ». Cette théorie semble avoir été abandonnée, mais il faut remarquer qu’elle ne portait que sur la localisation cérébrale de ces instincts, et non pas sur le fait que ceux-ci existent, ce qui est une évidence que personne ne nie.
Ainsi, il est aussi incontestable qu’il existe, chez l’homme comme chez l’animal, une « chaîne » naturelle, qui nous vient de l’héritage de tous les animaux sexués, et en particulier des mammifères supérieurs, dont nous faisons partie, et qui lie, pour assurer la reproduction de nos espèces, les fonctions affectives, sexuelles, génitales et éducatives. Ceci est un tout, qui construit ce que l’on appelle chez l’homme une « famille ». Chez les mammifères, tant les marsupiaux que les placentaires, les fonctions réciproques du mâle et de la femelle se sont différenciées, dès le début de leur expansion (la libération de la « trappe écologique » suite à la disparition des dinosaures), de sorte que la femelle s’est « spécialisée » pour assurer la gestation et l’éducation des petits, jusqu’à ce qu’ils soient adultes, alors que de l’autre côté, la fonction de mâle s’est constituée pour assurer la protection de la cellule familiale contre les autres mâles et les dangers extérieurs. Il faut remarquer que la fonction mammaire est apparue à la même époque chez la femelle, consolidant ainsi, avec la sexualité binaire et la différenciation des rôles mâle/femelle, la structure « familiale » qui est devenue la nôtre.
Les sociétés primitives et les religions n’ont jamais cherché à invalider cette construction « naturelle » et ce fonctionnement des instincts, issus du « fond des âges », de notre nature animale, imprimés dans notre « cerveau profond ». Bien au contraire, elles les ont respectés, « aménagés » et « solidifiés » au travers d’institutions comme le mariage ou d’autres normes. Elles les ont aussi « encadrés » avec des interdits comme celui de l’inceste, celui du meurtre des petits ne provenant pas du mâle ou, parfois, celui de la polygamie. Mais toute la construction culturelle, au fil du temps, de la sexualité humaine, on le voit bien, est issue de la sexualité primitive, animale. Il est d’autant plus étonnant que l’on cherche aujourd’hui à s’en affranchir totalement, et à « réinventer la lune », comme si notre passé « naturo-culturel » (les traces laissées dans notre psychologie et dans notre culture par notre nature animale, nos « instincts ») et culturel (les constructions ultérieures pour « civiliser » ces instincts) n’avait jamais existé.
Un autre aspect de ce déni du fonctionnement instinctif des êtres humains, peut être observé dans le choc traumatique post-avortement. Ce n’est pas l’objet de cet article que de détailler les différents aspects de ce traumatisme, même si le non-dit ne devrait jamais avoir cours sur cette question, qui mériterait de faire l’objet d’une large médiatisation, tant les chiffres semblent aberrants, si l’on en croit l’ouvrage du Dr Florence Allard (voir « Le traumatisme post-avortement », Salvator, 2007) qui traite de cette question :
– 50% des mères ayant avorté (soit environ 110.000 femmes, pour 220.000 avortements par an) présentent des symptômes d’un véritable « syndrome » : peur et culpabilité intense, dépression, perte de l’estime de soi ou du contrôle de soi.
– 30 à 50% des femmes ayant avorté sont victimes de dysfonctionnement sexuel, de durée plus ou moins longue : baisse du plaisir éprouvé, douleurs, aversion envers le partenaire, développement de conduites désordonnées : échangisme, vagabondage sexuel.
– Environ 60 % des femmes qui expérimentent des séquelles post-avortement, ont des idées suicidaires et 28 % font des tentatives de suicide dont la moitié répète une deuxième fois cette tentative.
– Le stress post-avortement est lié d’une manière significative à des conduites addictives : abus de tabac, d’alcool, de médicaments et de drogues, des désordres de l’alimentation, comme la boulimie et l’anorexie. On constate des problèmes de maltraitance sur les autres enfants, des problèmes de couples entraînant séparations et divorces.
Les différents aspects de ce traumatisme sont par ailleurs très bien décrits dans une étude qui s’appuie largement sur les travaux du Dr Stéphane Clerget et sur son livre « Quel âge aurait-il aujourd’hui ? » (Fayard, 2007). Celui-ci montre en particulier que la compréhension par les divers acteurs de l’avortement (mère, père, médecins, autres enfants, entourage) est particulièrement complexe, puisqu’ils assument chacun, simultanément et contradictoirement, les rôles de « bourreau », de « témoin » et de « victime ».
Pour ce qui est de la mère en particulier, plusieurs niveaux de compréhension sont présents en même temps :
– le niveau « rationnel » : la décision prise a été la meilleure, ou la seule possible, au regard des difficultés que promettait la venue attendue de l’enfant, ou même, parfois, dans le cas des IMG, des graves handicaps détectés
– le niveau « moral » : en effet, la rationalité n’efface pas la question morale (« ai-je bien fait de permettre que l’on tue mon enfant ? ») à laquelle la mère ne peut pas échapper. La contradiction, insoluble, entre rationalité et moralité, contribue évidemment au désarroi de la mère, à son impossibilité de faire son deuil, et à la durée de sa dépression.
Mais il existe une autre lecture, que le rapport et les travaux de Dr Clerget n’abordent pas. Elle provient précisément d’une lecture « naturelle », « instinctive », des rapports de la mère avec son enfant et avec le père. On sait que, chez les animaux supérieurs, l’attachement instinctif de la mère à sa progéniture est absolument primordial et remarquable, à tel point qu’elle n’hésite souvent pas à mettre sa vie en danger, si cela devient nécessaire, pour sauver ses petits. De même, on sait qu’elle choisit très soigneusement le mâle qui sera le père de ses enfants, en fonction de critères de force et d’agressivité, qui seront autant de garanties que celui-ci protègera ensuite son « foyer » des agressions extérieures. Ce deuxième instinct (ce qu’elle attend du mâle) est aussi important, et complémentaire du premier (ce qu’elle est prête à faire pour protéger ses petits).
Dans ce schéma, il existe donc un troisième niveau d’interprétation du traumatisme de l’avortement, autre que les lectures rationnelles ou morales. On peut ainsi considérer que, selon son instinct, la mère ne peut jamais accepter de donner son accord pour que l’on tue son enfant. C’est ancré au fond d’elle-même, au plus profond. Si elle se résout, à un moment, à le faire, c’est uniquement parce que la force des agressions et des contraintes extérieures (consensus sociétal, pression des médecins et de l’entourage, des obligations professionnelles, peur des conséquences dues au handicap futur de l’enfant, manque de garantie de prise en charge future de l’enfant dans ce cas, etc…) est trop grande. Mais en réalité, comme une lionne dont les lionceaux sont, malgré une héroïque défense, dévorés par les hyènes, et même si la profondeur de son instinct ne lui permet pas de l’analyser ainsi, elle reste et se voit, dans son intériorité la plus profonde, essentiellement comme une victime de ce drame.
Par ailleurs, de manière aussi instinctive, elle attend du père de ses enfants, en premier lieu, la défense de sa progéniture. Selon cette même lecture, on peut donc considérer logique que la mère, au fond d’elle-même, reproche au père, s’il ne s’est pas clairement positionné contre sa décision, de ne pas l’avoir suffisamment défendue contre les agressions qui ont conduit au choix tragique qu’elle a dû faire. Cela expliquerait pourquoi l’un des aspects du syndrome post-avortement concerne l’attitude vis-à-vis du père (agressivité, perte de libido, aversion) qui va jusqu’à la séparation puisque, selon la présentation du livre du Dr Allard, « 50% des couples qui vivent une IVG sont conduits à se séparer dans un délai assez bref ».
Il serait intéressant que, à la lumière d’une meilleure connaissance de nos comportements instinctifs, on puisse creuser cet aspect particulier du syndrome post-avortement. Cela permettrait probablement d’offrir une « sortie » (par une explication plausible) aux extrêmes difficultés de compréhension (à travers les multiples « lectures » possibles et questions, enchevêtrées, qu’elle se pose), qu’éprouve la mère. Ainsi, elle se verrait plus facilement comme la victime du drame, et moins comme le « témoin » passif, ou même le « bourreau », de la mort de l’enfant. Sa vision morale des choses pourrait en être apaisée. Cela permettrait aussi, peut-être, d’ouvrir un chemin pour la réconciliation des couples, en particulier par la demande de pardon du père à la mère pour le rôle de protecteur qu’il n’a pas su jouer.
Dans tous les cas, le fait de refuser de prendre en compte notre « psychologie profonde », pour ne considérer que la « rationalité » la plus superficielle de nos comportements, ne nous rendra ni plus intelligents, ni plus lucides, mais au contraire plus ignorants et aveugles. Cette prise de conscience nouvelle de la nature, dont témoignent, malgré leurs excès, les mouvements écologiques d’aujourd’hui, ne devrait pas éviter, justement, d’y intégrer ce qui concerne notre propre nature.
François Martin
Elu local et consultant international