
En 1992, au lendemain de l’effondrement de l’URSS, paraissait le livre-phare de l’époque : « La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme » de Francis Fukuyama. Une formule peut le résumer : » Un processus fondamental est à l’oeuvre, qui impose un schéma d’évolution commun à toutes les sociétés humaines, en bref, quelque chose comme une histoire de l’humanité dans le sens de la démocratie libérale. » L’inspiration hégelienne était claire. L’Histoire à un sens au double sens du terme, une direction et une signification. Sa fin correspond à la réalisation de l’Humanité, de ses aspirations à la liberté et à l’égalité. Simplement, Fukuyama adaptait la vision de Hegel à notre époque en minimisant le rôle rationnel de l’Etat qui avait pu réunir derrière Hegel des démocrates comme des totalitaires. A travers Gentile, c’est en effet Hegel qui servait de couverture philosophique au fascisme, ce qui prouve que l’interprétation des philosophes peut conduire les disciples affichés d’un même penseur sur des chemins étrangement opposés. Pour Fukuyama, la fin de l’Histoire célébrait le triomphe du libéralisme sous ses deux aspects : le capitalisme économique et la démocratie formelle, qui garantit des droits « de » aux individus mais non des droits « à », tout en leur donnant de meilleurs moyens de satisfaire ces derniers en raison du progrès économique, croyait-il.
Un quart de siècle plus tard, on peut se demander si le phare n’a pas conduit sur des récifs. Certes, le marché planétaire s’est étendu au travers des traités internationaux jusqu’à ces dernières années et au récent coup de frein donné par les populistes paradoxalement victorieux dans deux pays anglo-saxons. Les crises ont effet entamé sérieusement la confiance dans le système. Le sentiment que la croissance économique créait des profits, plus que de l’emploi et des salaires en progression, se muait en amertume et parfois en révolte. Mais surtout, la Démocratie politique, loin d’avancer, est en pleine régression. La rupture de solidarité entre l’économie et la politique accentue le malaise. Plus grande et plus ancienne démocratie du monde, les Etats-Unis sont la principale cause de cette déception. Brusquement devenus maîtres du monde dans les années 1990, ils ont opté pour une politique dénuée de prudence, passant de la défense à l’offensive, soit directement par des interventions militaires, soit par des pressions sur les gouvernements et des soutiens à l’opposition dans des Etats fragiles. Cette stratégie s’est développée au nom de la Démocratie et du Droit. On peut constater que la démocratie n’a nullement progressé, et que le droit des peuples et des Etats a souvent été bafoué. On peut même soupçonner Washington d’avoir visé des buts définis par ses intérêts ou tout au moins ceux que fixe l’Establishment américain au nom d’une idéologie peu cohérente dans les faits.
Il est clair que les actions militaires menées par les USA et leurs alliés, plus ou moins nombreux suivant les cas, n’ont eu aucun résultat positif en faveur de la démocratie. La première, avant même la chute de l’URSS qu’elle a accélérée, en Afghanistan avec l’aide du Pakistan et de l’Arabie Saoudite, a produit deux résultats négatifs à long terme. D’abord, dans ce pays la guerre n’est pas finie. C’est l’OTAN qui a remplacé les Russes pour empêcher les rebelles de prendre le pouvoir au régime, sans doute toujours aussi corrompu, de Kaboul. Les rebelles pachtounes autrefois armés par les Américains sont devenus les talibans qu’ils combattent dans un pays qui n’a jamais supporté la moindre présence étrangère, pratique la guerre comme un sport national, et conserve des coutumes « juridiques », notamment à l’encontre des femmes, incompatibles avec une démocratie. En second lieu, et c’est infiniment plus grave, l’aide américaine avec ses deux alliés islamistes, le foyer du wahhabisme et le pays des purs, a fait sortir le génie salafiste de sa bouteille. La lutte contre le terrorisme ne le fera pas rentrer. La défaite locale de l’Etat islamique ne l’empêchera pas de poursuivre son action ailleurs. Les autres organisations, malgré leur changement fréquent de nom, continueront, elles aussi. La chute de Saddam Hussein et de Kadhafi, les printemps arabes de manière générale, n’ont pas instauré la démocratie. C’est au contraire la guerre civile entre patriotes arabes et islamistes qui s’est installée en Syrie et en Libye, tandis qu’après avoir frôlé le totalitarisme des Frères Musulmans, l’Egypte a redonné le pouvoir, comme d’habitude, aux militaires. Pendant ce temps, obsédés par la menace iranienne et chiite, les Saoudiens, les grands alliés de Washington, interviennent férocement au Yémen, ce malheureux pays, autrefois appelé « l’Arabie heureuse », aujourd’hui victime des atrocités de la guerre. La famine touche des millions de personnes. Le choléra, engendré par les bombardements saoudiens qui ont détruit des stations de pompage de l’eau, frappe des centaines de milliers de yéménites. Enfin, la division du pays, permet aux salafistes d’Al Qaïda et de l’EI d’y prendre pied. Au Yémen, comme en Libye, le souhait de remplacer une dictature, celle de Kadhafi ou de Saleh, par une démocratie se termine en impasse : le pays est divisé entre le gouvernement soutenu par les Occidentaux et un pouvoir concurrent qui n’est pas sans rapports avec l’ancien régime. L’Irak est maintenant dirigé essentiellement par les chiites. On peut penser que c’est une avancée démocratique puisque ceux-ci sont majoritaires. Est-ce pour autant une démocratie ? L’axe chiite comprend l’Iran, l’Irak, la Syrie de Bachar Al Assad, et le Hezsbollah libanais. Sans doute est-il le plus à même, en collaboration avec les Kurdes et les autres minorités, chrétiennes notamment, de rétablir la paix dans cette région du monde. Sa victoire est toutefois un désaveu cinglant de la politique américaine. Elle ne pourra qu’entraîner des réactions des alliés paradoxaux de Washington, les Saoudiens et les Israéliens.
En fait, on doit légitimement formuler l’hypothèse que la continuité américaine visait moins l’instauration de la démocratie universelle que l’élimination de la Russie comme grande puissance. Ce n’était pas Hegel, mais Metternich ou Bismarck, les références d’Henry Kissinger, qui en étaient les inspirateurs. Ce n’était pas la fin de l’Histoire mais son inlassable poursuite. ( à suivre)



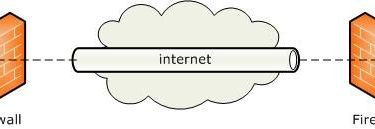
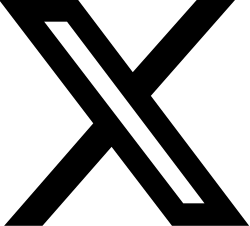

3 Comments
Comments are closed.