Monsieur,
Si vous aviez choisi de vous suicider chez vous, dans vos toilettes ou dans votre cave, je n’aurais pas eu à vous écrire cette lettre, car je n’aurais, somme toute, pas grand-chose à dire de votre acte. Mais vous avez fait le choix de vous donner en spectacle à Paris, dans la cathédrale la plus admirée de France, et de vous y donner la mort en signe de protestation politique, selon la lettre que vous avez laissée. C’est bien parce que votre acte est un geste politique et non personnel que je me vois incité à réagir.
De par le battage médiatique soulevé par votre acte, vous avez déjà gagné la bataille de l’image et du bruit. Votre nom et votre pensée sont maintenant connus de tous. Vous avez habilement su manipuler les singes journalistes, et cela a fonctionné à merveille. Votre éditeur se frotte les mains, puisque vous lui avez permis de réaliser une publicité événementielle exceptionnelle pour votre dernier livre en préparation. En effet, il déclare que votre acte revêt « une puissance symbolique extrêmement forte » qui vous rapprocherait d’un grand auteur japonais ayant lui aussi mis volontairement fin à ses jours. Peut-il y avoir quelque chose de plus fort comme acte publicitaire et situationniste qu’un suicide minutieusement préparé ?
Pour moi, sachez-le, vous n’êtes ni un brave, ni un samouraï, ni un résistant, ni un guerrier. Vous êtes un terroriste intellectuel, tout comme Anders Breivik le fut lorsqu’il assassina froidement 77 personnes en Norvège voici bientôt deux ans, faisant ainsi la promotion de son manifeste identitaire de plus de 1500 pages. En effet, je prends votre acte au sérieux et non à la légère comme le font ceux qui ne voient sous votre geste qu’un acte de désespoir personnel. Vous êtes un terroriste intellectuel parce que vous imposez au monde la violence de votre acte et en vous donnant la mort, vous empêchez que l’on puisse vous répondre. C’est par l’éclat du sang et la frayeur que provoque une mort violente que vous diffusez vos idées.
Vous n’avez certes entraîné dans la mort personne d’autre que vous-même, mais c’est là tout le paradoxe. Un meurtrier peut être jugé, peut être puni pour réparer, même symboliquement, ses actes. Mais un suicidé, non. Qu’attendent les familles de victimes de la part d’un meurtrier ? Pourquoi viennent-elles assister au procès ? Pour tenter de comprendre ce qui a motivé l’acte qui a retiré la vie de l’un de leurs proches, pour savoir si le remords peut naître dans son cœur, pour demander justice, et enfin pour savoir si un pardon sera possible, afin de faire le deuil du drame qui les afflige.
Face au suicide, comment comprendre, comment obtenir réparation, comment pouvoir un jour poser un pardon ? Toute mort violente crie vengeance. Qui vengera la vôtre ?
Je n’ai pas peur de l’abîme qui nous sépare, et c’est pourquoi j’ose m’adresser à vous qui avez fait le crime de vous assassiner vous-même. Votre acte m’a mis en colère, car il est contraire à toutes les valeurs que je défends en me battant notamment contre l’effondrement de notre civilisation à travers la loi Taubira (instaurant le mariage pour les personnes de même sexe). Je défends la vie, sa beauté, son audace, sa force et sa fragilité. Par votre acte, vous encouragez la violence, la colère et la haine. Voilà pourquoi, par cette lettre, j’exorcise la colère que vous avez provoquée en moi afin peut-être d’arriver à vous remercier.
En effet, à la suite de votre acte, de nombreuses personnes se sont mises à vous encenser, vous voir comme un résistant, un héros, un chevalier ou je ne sais quelles sornettes encore. Les mots de « courage », de « respect », de « puissance d’exister » semblaient être sur presque toutes les lèvres. Votre acte m’a permis de voir que toutes ces personnes – militantes comme moi contre cette loi dite du « mariage pour tous » – étaient bien loin de partager mes valeurs. Certains parlent d’honneur et citent en référence le capitaine qui se laisse couler avec son bateau ou encore le japonais bien en vu, qui, face à l’échec se fait seppuku. Je ne vois là aucun honneur, seulement un orgueil tout-puissant et une blessure narcissique que l’on n’a pas le courage d’avouer.
Tous ces gens qui vous admirent sont finalement des partisans de cette vieille droite nationaliste païenne, sans espérance, idolâtre de sa propre violence et engloutie sous les torrents d’une idéologie poisseuse digne d’un surhomme décadent à la sauce wagnérienne. Je vous remercie donc de m’avoir permis d’ouvrir les yeux sur ce qu’étaient véritablement ces partenaires éphémères de combat.
En parlant de Notre-Dame, vous avez évoqué le fait qu’elle fut bâtie sur d’anciens lieux de culte païens, et vous avez ainsi donné à votre suicide une notion de sacrifice. J’accepte cette idée, mais pas comme vous le pensez. En enfonçant librement le canon dans votre bouche, vous vous êtes séparés de votre plus grand bien : la capacité de choisir la vie. Le seul sacrifice que vous avez opéré est celui de votre intelligence. Ainsi, vous n’êtes pas mort en maître d’armes, vous, le passionné des fusils et des revolvers, vous êtes mort en esclave : l’outil aura eu raison de son maître, car le maître a renoncé à gouverner sa vie.
Toute votre vie, vous avez voulu, paraît-il, défendre la civilisation européenne, son héritage et sa culture. Votre dernier acte balaie d’un revers de main tous ces efforts.
Défendre notre civilisation, c’est refuser de s’enfermer dans le désespoir, c’est se tenir debout au milieu d’un monde qui s’effondre, c’est protéger les germes de vie comme autant de miracles à éclore, c’est faire preuve de créativité devant la banalité du monde, c’est montrer de l’audace quand tout le monde baisse les bras, c’est renoncer à la grandeur des siècles passées pour bâtir un présent dont la splendeur n’a pas d’égal, c’est enfin rester auprès de sa femme, de ses enfants, de ses proches et de son peuple quand le jour du combat approche et qu’il nous faut nous montrer solidaires et vaillants, ce n’est pas abandonner les siens dans le bruit et la fureur.
Voilà pourquoi je prends la plume pour vous dire combien votre acte me répugne.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments écœurés les plus sincères.


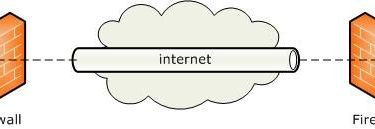
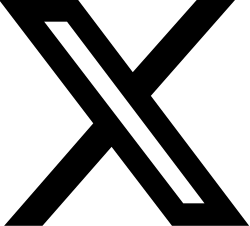

234 Comments
Comments are closed.