Il y a deux manières d’aborder le problème posé par la situation d’Alstom. Soit on s’en tient à l’intérêt industriel du projet, soit on pose de façon plus large la question de l’avenir économique du pays. Dans le premier cas, la solution la meilleure à court ou moyen terme réside dans la reprise par Général Electric du secteur énergie d’Alstom. Comme le PDG Patrick Kron, suivi par le Conseil d’Administration l’ont pensé, la complémentarité des entreprises et la nécessité de constituer un géant dans la production des turbines pour faire face à la concurrence asiatique fournissent les arguments de la meilleure réponse aux difficultés actuelles du groupe français. GE pèse autant que Alstom et Siemens réunis, et sa division énergie, une fois et demie l’ensemble du groupe français. Il fournit plus de 30 turbines à gaz par mois quand Alstom se limite à 10 par an. Les savoirs-faire de l’Américain sont complémentaires de ceux du Français. Il paye la reprise 12,35 milliards. Or Alstom a besoin de fonds pour investir, toujours pour faire face à la concurrence, cette fois dans sa branche transport.
Selon une habitude de moins en moins légitime en fonction de ses moyens, l’État a cru nécessaire d’intervenir. Avec une emphase de plus en plus ridicule, Montebourg a évoqué une « vigilance patriotique », s’est plaint de ne pas avoir été informé des contacts par le PDG d’Alstom alors qu’il lui posait la question. Le Président de la République a cru bon de recevoir le PDG de Général Electric. Ces gesticulations n’ont pas modifié les intentions. Elles ont tout juste permis à l’exécutif de chercher à faire croire que notre Etat providentiel avait obtenu des garanties du groupe américain pour le maintien de l’emploi et des sites, le développement de la recherche en France et le respect de la souveraineté française. Elles ont aussi permis de constater que le soutien de l’exécutif à une solution plus européenne avec Siemens était de peu de poids. On est habitué aux rodomontades de notre Ministre verbalement très productif : ni sur Mittal à Florange, ni sur SFR, ni sur Titan à Amiens, les effets de manche de notre avocat n’ont eu de résultat. A nouveau, c’est l’échec, qui témoigne de deux faiblesses : d’abord, l’appauvrissement de notre pays, qui n’a plus les moyens d’agir, ensuite l’ignorance totale de nos dirigeants sur la conduite des entreprises. Celles-ci ont besoin de secret. Quand l’État n’a plus de part dans leur capital, il n’y a aucune raison qu’elles affaiblissent leur stratégie par des considérations politiques, et encore moins qu’elles s’exposent à des manipulations médiatiques.
En 2004, Sarkozy avait tiré un avantage politique évident d’un premier sauvetage d’Alstom, en grande partie préparé par son prédécesseur à l’Économie, Francis Mer. La participation de l’État, le délestage de quelques activités avaient permis à l’entreprise de surmonter un endettement dangereux. La Commission européenne avait accepté le plan français en formulant des exigences. On a considéré que Sarkozy avait été un excellent avocat, mais cette affaire figure parmi celles qui ont persuadé les Français que l’Europe était un obstacle et non un levier. Deux ans plus tard, l’État revendait ses parts à Bouygues, qui aujourd’hui détenteur de près de 30% du capital, souhaiterait se retirer. A l’époque, une volonté politique claire de maintenir l’industrie nationale et de sauver les activités qui pouvaient s’intégrer dans une stratégie d’excellence de la France à l’international, avait été privilégiée. Aujourd’hui, l’exécutif affirme privilégier l’emploi, et l’Europe. Or, les activités redondantes de Siemens par rapport à Alstom conduiront nécessairement à la suppression d’un certain nombre de doublons. Cherchez l’erreur ! D’ailleurs, on ne le dira jamais assez, l’emploi est une conséquence de l’activité d’une entreprise, et non son objectif. Les pays qui ont musclé leur compétitivité n’ont pas fait du chômage la priorité, mais ils ont obtenu sa diminution comme une conséquence de réformes structurelles qui ont pu l’augmenter dans un premier temps. C’est ce qui s’est produit sous les gouvernements de Mme Thatcher au Royaume-Uni. Posséder une industrie performante, par la qualité de ses produits, l’avance de sa recherche, le choix de ses créneaux permet même de laisser au second plan le coût du travail. Les Allemands ou les Suisses en fournissent la démonstration. Le drame de notre pays est de voir régresser les activités où il était champion, tout en maintenant un coût du travail et une fiscalité d’entreprise peu compétitifs. Il est souvent nécessaire de préférer l’investissement à l’emploi, ce qui est le plus sûr moyen de préserver voire d’améliorer ce dernier à long terme et de manière globale. Ce choix que Sarkozy avait proclamé en 2008, après la crise, ne s’est pas traduit par une politique cohérente, sélective et efficace. C’est cet échec qui crée le sentiment que notre puissance industrielle est entraînée dans une spirale de déclin, et que l’État lui-même n’a plus les ressources nécessaires pour arrêter le processus. L’État participe au capital de Peugeot, mais aux côtés d’un partenaire chinois. L’État doit-il intervenir à nouveau dans un domaine stratégiquement peut-être plus important que l’automobile, celui de l’énergie ? Le discours de nos gouvernants actuels fait preuve d’un amateurisme angoissant. Ils ne paraissent rien y connaître, multiplient les contresens et surtout leur incompétence qui a galopé pendant deux ans a réduit les marges de manoeuvre du pays. Un pays obligé de se serrer la ceinture sous la surveillance de Bruxelles a-t-il les moyens d’investir pour sauver ses industries, ou leur conserver une identité nationale ?


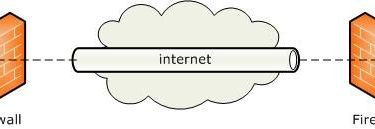
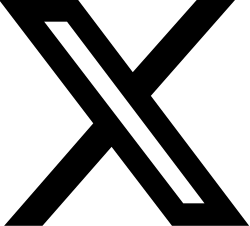

5 Comments
Comments are closed.