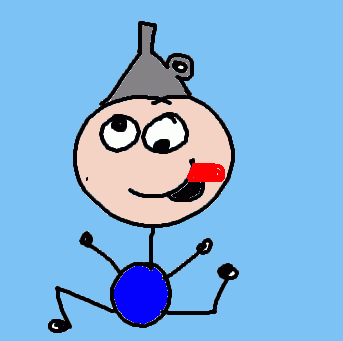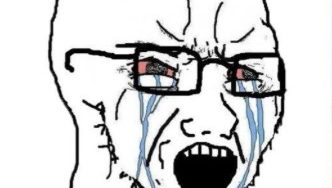Monument de la littérature italienne, inventeur du “roman existentialiste”, bien avant Sartre et Camus, Moravia a porté sur l’homme du XXe siècle, dominé par la religion du sexe et de l’argent, un regard sans complaisance, d’une ironique lucidité parfois même teintée de cruauté.
Atteint d’une tuberculose osseuse à huit ans, Alberto Moravia est de ces écrivains dont la destinée littéraire est liée à la maladie. Si sa vocation ne doit pas grand-chose à la vie réglée des sanatoriums, le sentiment de la fragilité de sa propre existence, le fait d’être tôt coupé des autres et de son milieu ont joué dans la manière dont son talent s’est exprimé en contribuant à forger son regard original et profondément décentré. “Probablement à cause du long isolement dû à la maladie, moi, le plus souvent, j’ai la tête totalement vide, je suis dans un état de contemplation ou […] de distraction absolument spontanée1”.
Alberto Pincherle – Moravia, son nom de plume choisi parce qu’il y avait déjà un Pincherle, était en fait le patronyme de sa grand-mère paternelle – vit le jour à Rome le 28 novembre 1907 dans une famille bourgeoise aisée, deuxième des quatre enfants d’un couple qui n’était pas un modèle d’amour conjugal. Le père, Carlo Pincherle, était un ingénieur architecte issu d’une famille vénitienne, ce qui était important à ses yeux, et d’origine juive, ce qui ne comptait pas beaucoup. Bien que sa carrière d’architecte se soit ralentie faute de clients, il avait gagné assez d’argent pour entretenir sa famille. Il fut même l’un des premiers Romains à posséder une automobile. Casanier, routinier, timide, colérique aussi, il ne supportait pas la vie de famille, disparaissant souvent pour aller travailler ou se promener. Piqué de peinture, il ne s’adonnait à son hobby que lorsqu’il retournait à Venise, pendant ses vacances. De vingt ans plus jeune, sa femme, Teresa Iginia de Marsanach – Gina dans le cercle familial -, était catholique quoique peu dévote. Malgré un bon sens paysan qui la maintenait dans le réel, la mère d’Alberto souffrait du même mal qu’Emma Bovary, ses aspirations à mener une vie mondaine n’étant guère satisfaites par son époux. Quand on l’interroge sur sa famille, cette “forteresse d’égoïsme primitif2”, Alberto la décrit volontiers comme “normale”, ajoutant “l’anormal, c’était moi”.
Le désir de raconter des histoires et la passion de la lecture furent en fait antérieurs à la catastrophe qui frappa le petit Alberto, lorsqu’en 1916 il s’effondra dans la rue : il rédigeait déjà dans des cahiers le plan de son premier roman4. Les médecins mirent trois ans à diagnostiquer la maladie, une forme sèche, sans abcès, de la tuberculose qui se manifestait par de forts accès de fièvre et des contractions musculaires qui évoquaient des crises d’épilepsie. De neuf à dix-sept ans, la vie d’Alberto Pincherle fut ainsi marquée par la maladie : “J’avais l’impression d’avoir toujours été malade […]. Mon enfance, à partir de huit ou neuf ans, ne fut qu’une longue suite de rechutes. Je vivais au lit5.” Son état ne s’améliora qu’à partir de mai 1924, quand il fut envoyé au sanatorium flambant neuf de Codivilla à Cortina d’Ampezzo, où l’on pratiquait l’héliothérapie. Alberto y fit l’expérience de la solitude radicale, “solo col sole6″ (“seul avec le soleil”). La nouvelle Hiver de malade(1930) décrit la vie au sanatorium, Moravia s’en servant de cadre pour narrer les relations complexes entre un adolescent timide, Girolamo, et son compagnon de chambre, Brambilla, un voyageur de commerce assez vulgaire, mais qui fascine Girolamo par ses techniques de drague, tout en le provoquant socialement. Ce fut aussi là-bas que Moravia comprit pourquoi Dostoïevski – qu’il avait commencé à lire à l’âge de dix ans7 – était l’écrivain qui, en déplaçant le centre de gravité du roman, l’avait le plus influencé : “Au rapport entre individu et société […], il a substitué le rapport entre l’individu et lui-même8.”
Le sexe et l’ennui
Pendant son séjour au sanatorium, il rédigeait des poèmes et des essais de roman qu’il envoyait à sa tante Amelia, la plus à même de le comprendre. A Dacia Maraini, la compagne qui partagea sa vie jusqu’en 1978, après sa séparation d’avec Elsa Morante, autre grand écrivain italien, il confia avoir été précocement “désemparé par le sexe9”, allant jusqu’à attribuer aux révélations sur la masturbation que des garnements de Viareggio lui avaient faites l’origine psychosomatique de sa maladie : “Peut-être n’ai-je pas résisté à la révélation des choses du sexe et de la classe sociale, que j’avais eue à Viareggio10.” Plus nettement encore, il dit à Jean Duflot : “Pour ma part, tout m’incite à croire que la tuberculose osseuse que j’ai contractée a eu une origine psychosomatique. […] J’ai traversé alors une véritable crise existentielle provoquée par un dégoût de vivre11.”
Moravia n’était pas médecin, mais il est certain qu’il a ressenti profondément cette forme moderne d’acédie qui se traduit par le sentiment d’être étranger au monde, coupé de la vie, incapacité qui alimentait par compensation le mauvais infini d’une sexualité vouée à l’échec. C’est une constante de son oeuvre romanesque que de créer des personnages qui sont conscients du caractère factice et inauthentique des rapports humains tout en aspirant, sans pouvoir y parvenir, à autre chose. De là, les multiples variations sur le thème de l’ennui, de l’inattention, de l’indifférence que Moravia dépeint avec justesse et simplicité : “L’aspect principal de l’ennui était l’impossibilité pratique de rester en face de moi-même, seule personne au monde d’autre part de laquelle je ne pouvais me défaire d’aucune façon12”, déclare Dino, le peintre raté de L’Ennui(1960), l’un des romans les plus accomplis. Une lucidité du héros qui ne déclenche le plus souvent aucune action rédemptrice, comme si la conscience de son état ne faisait que contribuer à l’y enfoncer davantage, comme Dino tant dans son rapport avec la femme avec qui il vit que dans sa relation à la peinture : “Avec Cecilia, j’oscillais entre l’ennui et la manie sexuelle, de même dans l’art, j’oscillais entre la mauvaise peinture et la non-peinture.”
Au sortir de la phase aiguë de sa maladie, Moravia était assez sûr de sa vocation pour ne pas reprendre ses études. Il fréquenta à Rome un groupe d’avant-garde littéraire, réuni autour de Massimo Bontempelli, proche du surréalisme, l’inventeur du “réalisme magique”, qui animait, avec Curzio Malaparte, la revue Novecento. Les écrivains en puissance qui y contribuaient s’étaient engagés à livrer, au bout d’un an, un roman. Moravia fut le seul à tenir sa promesse. Son manuscrit, Les Indifférents, n’en fut pas moins refusé par l’éditeur de la revue, au motif que c’était un “brouillard de mots13”. “Le premier pont qu'[Alberto] tentait de jeter au-dessus du vide, du gouffre de [sa] vie”, “[son] premier essai de “langage”14” ne put déboucher sur une parution que grâce aux 5 000 lires que son père avança à l’éditeur milanais Alpes pour une publication à compte d’auteur. Ce fut un succès. Il valut la célébrité à Moravia à défaut d’argent. Pensionné (modestement) et hébergé par son père, il ne put gagner son indépendance qu’à partir de son mariage avec Elsa Morante et vivre avec aisance qu’après ses succès de l’après-guerre. Peu apprécié par les autorités fascistes qui ne comprirent pas que ce jeune homme de vingt ans avait surtout écrit un roman contre l’indifférence, Moravia améliorait son ordinaire en travaillant pour des journaux et pour le cinéma.
“Créer la chose avec le mot”
Conçus comme une tragédie dont l’action se déroule sur deux jours, mais sans dénouement tragique, Les Indifférents (1929) sont une sorte de huis clos entre cinq personnages. Michele et Carla – gli indifferenti – sont les enfants d’une veuve encore jeune, vaniteuse et égoïste, Mariagrazia, dont l’amant Leo, homme d’affaires trop bien adapté à un monde dominé par le sexe et l’argent, a tout de l’aventurier cynique. Leo a des vues sur la fille Carla et sur la maison déjà hypothéquée. Ayant bien compris qu’elle exerçait sur lui un attrait, et pour “entamer une nouvelle vie”, Carla a décidé de coucher avec Leo le lendemain, jour de ses vingt-quatre ans, relation aux vagues relents d’inceste, Leo se plaisant à la considérer comme sa fille. Sorte de Hamlet au petit pied, Michele tente désespérément de jouer à l’homme de la maison, envisageant même de tuer Leo, tout en se sentant ridicule face à lui. La tragédie confine au mélo, mais Moravia, justement, ne tranche pas. Michele finit par céder aux avances de Lisa, la meilleure amie de sa mère et l’ex-maîtresse de Leo. Le roman oppose ainsi des “adultes” corrompus, Leo, Mariagrazia et Lisa, qui sous des dehors d’honorabilité dissimulent un insatiable désir de jouissance, à une jeunesse apathique, irrésolue, encore indifférente à ce qui va faire d’eux des adultes comme les autres, sans idéaux.
“C’est avec Les Indifférents que j’ai réellement appris à écrire, que j’ai appris à créer la chose avec le mot15.” Conteur-né, soucieux avant tout du rythme de sa phrase, ne ponctuant son texte qu’après coup, Moravia, qui avait écrit son ouvrage en position allongée – le lit étant “devenu pour [lui] comme [la] coquille pour l’escargot16” -, avait inventé une sorte de prose poétique, un style sec, sobre, tendu vers l’expression de la vérité, sans fioritures ni descriptions inutiles, entièrement tendu vers l’expression de la vérité. Talent précoce, Moravia avait aussi l’impression d’avoir dit dès son premier livre tout ce qu’il pouvait alors dire. Ni le recueil de ses nouvelles, ni son deuxième roman Les Ambitions déçues(1935), ni a fortiori Le Quadrille des masques(La Mascherata, 1941), satire du fascisme mussolinien transposée au Mexique qui échappa “miraculeusement à la censure17”, ne lui permirent de renouer avec le succès des Indifférents.
Romancier de l’adolescence
Il fallut la guerre et la publication d’Agostino(1944), nouvelle relatant la passion incestueuse, quoiqu’innocente, d’un adolescent pour sa mère, pour que Moravia retrouve la veine créatrice desIndifférents. Dans ce roman de formation ou plutôt d’initiation, Agostino, le narrateur, fait part de son désarroi devant la découverte de la sexualité, la sienne, enfant innocent qui s’aperçoit qu’il n’en est plus un, mais aussi celle qu’il voit se nouer entre une mère vénérée et un jeune garçon de plage. Outre la réalité du sexe, l’adolescent découvre brutalement celle des rapports de classes à travers la haine qu’il suscite chez de jeunes gamins pauvres dont il voulait gagner l’amitié. Trop jeune pour être acteur de sa vie, Agostino demeure un rêveur, nostalgique d’un pays “où il serait accueilli comme le souhaitait son coeur, où il lui serait possible d’oublier tout ce qu’il venait d’apprendre et de le réapprendre après, sans être blessé, ni honteux, d’une façon douce et naturelle qui devait exister, qui était celle qu’obscurément il avait désirée18”. Bref il aurait voulu qu’on lui laisse le temps de devenir un homme, “seulement voilà, il n’était pas encore un homme et lui faudrait vivre et souffrir bien longtemps avant d’en être un19”.
La Désobéissance (1948), qui obtint le prix Strega, est aussi un roman sur l’adolescence ou plutôt sur le moment où, à travers l’initiation sexuelle, Luca, un adolescent tourmenté et incapable de s’adapter au monde, tente de sortir du tunnel, et de rompre avec l’idée désolante que “c’était cela vivre, cela continuer à vivre : faire avec passion et ténacité des choses absurdes et insensées, pour lesquelles il était impossible de fournir la moindre justification et qui mettaient continuellement ceux qui les faisaient dans un état de servitude, de remords et d’hypocrisie20”. La guerre allait permettre aussi à Moravia de sortir en partie de l’atmosphère close qui caractérise ses romans, l’ouvrant à d’autres dimensions de l’existence humaine.
 La rencontre de l’Histoire
La rencontre de l’Histoire
Déjà, avec La Belle Romaine(1947), qui narrait les aventures d’une prostituée et d’un étudiant antifasciste qui avait trahi sa cause, Moravia avait touché un public traumatisé. La guerre lui avait aussi fourni l’occasion de voir la misère de près et de mieux connaître le peuple. Aussi Le Conformiste(1951) et La Ciociara(1957)se distinguent par l’influence plus directe de l’Histoire sur la vie des personnages.
Le Conformiste suit le parcours d’un jeune héritier, Marcello Clerici, adolescent habité par des instincts violents et persuadé d’être “anormal” – il tue des lézards, un chat et finit par tirer sur Lino, le chauffeur de maître pédophile et prêtre défroqué qui l’avait agressé sexuellement, ce qui avait, par ailleurs, fait prendre conscience à Marcello de ses tendances homosexuelles. Devenu adulte, rongé de culpabilité, Marcello veut à tout prix être “un homme normal”, un homme comme tout le monde, un conformiste. C’est ainsi qu’il devient une proie du fascisme. Celui-ci fait de cet homme moyen, devenu fonctionnaire au ministère de l’Intérieur, un assassin ordinaire, l’un des rouages anonymes du régime. ?uvre morose, le livre ne connut pas le succès des autres romans de Moravia parus après guerre.
En lien plus étroit encore avec l’Histoire et récit presque autobiographique, La Ciociara(1957), du nom des montagnes dans lesquelles Elsa et Alberto s’étaient réfugiés entre 1943 et 1944, est un roman sans intrigue, narré par Cesira, petite paysanne, trapue mais belle, robuste ciociara immigrée à Rome où elle est devenue commerçante en épousant un boutiquier. Comme dans La Belle Romaine, le narrateur est donc une femme, auquel Moravia prête son “bon sens”. Cesira, désireuse d’échapper à l’Histoire et de fuir les troubles qui menacent Rome à l’été 1943, se réfugie dans sa montagne natale, avec sa fille Rosetta. L’avancée alliée étant provisoirement stoppée, elles sont contraintes d’y demeurer plus longtemps que prévu. Confrontée aux privations et aux souffrances – Rosetta est violée par des soldats marocains censés venir les libérer – Cesira s’affermit au contact de sa terre natale : “Eh ! oui, nous sommes des plantes autant que des humains, et c’est de notre terre natale que nous tirons notre force ; si nous l’abandonnons, nous ne sommes plus ni plantes, ni hommes, mais de ces pauvres loques que la vie entraîne çà et là, au gré des circonstances21.” Femme du peuple, directe, Cesira n’est pas coupée de la réalité comme nombre de petits-bourgeois éthérés créés par Moravia. La Ciociara était aussi le point d’orgue du “mythe national-populaire22 ” qui fut, après guerre, une des raisons des succès de Moravia. Le Mépris(1954) et plus sûrementL’Ennui le ramenèrent à ses thèmes de prédilection, l’angoisse de vivre et “l’impossibilité d’établir à travers le langage un rapport quelconque avec la réalité23”.
Un roman de gare ?
Jean-Luc Godard aurait pu être plus inspiré lorsqu’il qualifia Le Mépris de “vulgaire et joli roman de gare24”, alors que Moravia tenait cette oeuvre en haute estime. L’auteur y raconte l’histoire d’un jeune écrivain, Riccardo, qui aimerait se consacrer à l’écriture de pièces de théâtre, mais qui, pour vivre, doit rédiger des critiques de cinéma, et d’Emilia, sa jeune épouse, une dactylo casanière et ordonnée, qui aspire à un bonheur bourgeois. Après deux années de mariage, Riccardo achète à crédit un appartement, pour satisfaire le désir de confort de son épouse et, croit-il, lui témoigner son amour. Mais, les traites à honorer le rendent anxieux, irritable et le conduisent à accepter la proposition d’un producteur de cinéma, Battista, d’écrire des scénarios pour lui. Un événement anodin – une méprise – transforme la perception qu’a Emilia de son mari. Celui-ci la laisse monter dans le cabriolet à deux places du producteur, Riccardo les suivant en taxi. Emilia est persuadée que son mari la livre au désir de son commanditaire pour s’assurer son emploi. Leurs rapports se dégradent jusqu’à ce qu’Emilia lui exprime son mépris : “Tu as voulu la vérité : eh bien ! je te méprise et tu me dégoûtes.” Emilia clame en fait son refus d’être une monnaie d’échange. Riccardo prend conscience qu’en renonçant à son idéal, en acceptant de faire “ce que veulent les autres”, il a avalisé le fait que l’argent et la position sociale soient l’unique mesure du mépris de l’autre et de l’estime de soi. Moravia démontrait ainsi comment l’argent, lorsqu’il n’est plus un simple instrument d’échange mais devient le fondement d’une échelle de valeurs unique, détermine au coeur de leur intimité les relations entre les êtres.
L’envers de l’ennui
Si “vue de l’extérieur, [sa] vie d’écrivain pouvait même donner une certaine impression de monotonie25”, cette dernière le conduisait aussi à se renouveler. “L’ennui a été mon grand inspirateur26.” Cette “dialectique de l’ennui” qui se convertit constamment en son opposé s’est traduite par le goût profond de Moravia pour les voyages. En effet, s’il fut très certainement un Romain – Rome lui assurant “une sensation d’éternité rustique, éternité qui se traduit en cynisme, en scepticisme et qui pousse à croire que rien ne changera27” – il fut, dès les années 1930, un voyageur invétéré, sauf pendant la guerre. Voyager était pour Moravia un antidote – comme l’écriture, d’ailleurs – à l’ennui et un moyen de “débloquer” son inspiration. “La vie sédentaire raccourcit la vie, le voyage l’allonge28.”
De 1930 à sa mort, Moravia voyagea donc beaucoup, nourrissant un autre versant de sa production, celui d’écrivain voyageur. Les destinations et les raisons de voyager changèrent avec le temps, le jeune écrivain “intellectuel” voyage en Europe, aux Etats-Unis (en 1935) et en Chine (en 1937) où “tout était comme du temps de Marco Polo29”, pour fuir l’atmosphère fétide du régime fasciste qui le tenait pour un écrivain décadent. Après la guerre, dans le contexte de la guerre froide, il visita les pays de la civilisation industrielle, l’URSS, le Japon et les Etats-Unis (en 1955, après plusieurs refus de visa, car il n’était pas assez “atlantiste30”). Confirmation pour lui que, dans la civilisation industrielle, toute création et toute forme de vie deviennent des “produits culturels” et que l’homme se racornit dans l’univers de la consommation de masse. Ce sont ces raisons qui le conduisirent à trouver en Inde, en Amérique du Sud et surtout en Afrique qu’il découvre avec Dacia, à partir des années 1960, un envers du monde moderne où l’imprévu et l’aventure n’ont pas encore laissé la place à la répétition du même. L’Afrique moravienne n’est sans doute pas exempte de lieux communs, il la voit comme un “monument de la nature31”, mais elle demeure un continent encore capable de donner site à l’homme qui y vit, en tout cas de frapper de stuporeun Moravia qui la voit à travers son regard d’écrivain.
L’Afrique, métaphore de cette “réalité rugueuse à étreindre”, seule susceptible de “[battre] en brèche sa tendance à tout conceptualiser32”, demeure, même après sa séparation d’avec Dacia, une ultime source d’inspiration. L’action de son dernier roman, La Femme léopard,dont on trouva, le matin de sa mort, la dernière version sur son bureau,ne se situe pas au Gabon par hasard. Y réapparaît le “triangle” moravien, comme dans L’Amour conjugal, L’Ennui ou Le Mépris, le couple et ses impasses et le tiers offrant l’illusion d’une issue. Dans le cas d’espèce, le narrateur, Lorenzo, photographe, Nora, sa femme, “félin énigmatique et impénétrable” comme la forêt équatoriale vers laquelle ils voyagent en compagnie de Pier Colli, l’ami et le patron de Lorenzo, pour lequel Nora éprouve de l’attirance. Ada, la femme de Colli, vient compléter le triangle et offrir des alternatives en miroir à l’intrigue.
La conclusion du roman est tragique : Colli se noie bêtement dans le canot qui ramenait les deux couples de la lagune à la léproserie où les avait conduits une expédition aux accents conradiens, laissant Lorenzo à ses doutes d’homme jaloux : on ne saura pas si Nora a cédé ou non aux avances de Pier. Nora, l’Afrique, la réalité, tout redevenait impénétrable à son personnage, tout comme à Moravia, comme si celui-ci concédait in fine à l’éditeur qui avait refusé Les Indifférents que les mots, même ceux du romancier, ne parvenaient pas à dissiper le brouillard.
1. Vita di Moravia, p. 197 (cité par R. de Ceccatty, p. 349, par M.Maigron, p. 17). 2. Le roi est nu, p. 17. 3 Vita di Moravia, p. 9. 4 Vita di Moravia, p. 24. 5 Le Petit Alberto, p. 136. 6 Vita di Moravia, p. 24. 7 Le roi est nu, p. 28. 8 Vita di Moravia, p. 43. 9 Le Petit Alberto, p. 90. 10 Vita di Moravia, p. 16. 11 Jean Duflot, Entretiens avec Alberto Moravia, p. 9. 12 L’Ennui, GF, p. 64. 13 Vita di Moravia, p. 54. 14 Jean Duflot, Entretiens avec Alberto Moravia, p. 15. 15 Le roi est nu, p. 39, cf. aussi Vita di Moravia, p. 37. 16 Vita di Moravia, p. 37. 17 René de Ceccatty, Alberto Moravia, Flammarion, p. 218. 18 Agostino, GF, p. 111. 19 Agostino, GF, p. 158. 20 La Désobéissance, LdP n°195, p. 146, Folio, p. 110. 21 La Ciociara, p. 130. 22 Vita di Moravia, p. 227. 23 Vita di Moravia, p. 228. 24 Cahiers du cinéma, août 1963, n°146. 25 Vita di Moravia, p. 275. 26 Vita di Moravia, p. 275. 27 Le roi est nu, p. 22. 28 Alberto Moravia, “Se fossi un archeologo” (“Si j’étais un archéologue”), paru dans L’Unità, 10 octobre 1978. 29 Vita di Moravia, p. 110. 30 Vita di Moravia, p.173. 31 Io e il mio tempo, conversations avec Ferdinando Camon, p. 53. 32 L’enfance d’Alberto, p. 57.