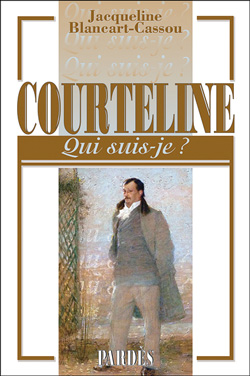Dans la collection Qui Suis-je ? de chez Pardès, Jacqueline Blancart-Cassou est en train de bâtir peu à peu une véritable histoire du théâtre : son Courteline (1) vient après un Labiche, un Feydeau, un Ghelderode qui m’a beaucoup appris sur cet étrange dramaturge belge, et un Anouilh plus remarquable encore, inégalé, peut-être parce qu’elle est plus à l’aise avec les années 1950 qu’avec les années 1900. Je lui reproche au fond, dans son Courteline, des arrière-plans historiques un peu sommaires. Sa guerre de 1870-1871 fait plutôt penser à 1940 (« l’ennemi attaque où on ne l’attendait pas », puis les troupes allemandes défilent aux Champs-Elysées)… Celle de 14-18 n’est guère plus précise, car en 1914 Pierre Loti, ami très cher dont Courteline possédait le portrait peint par le Douanier Rousseau, n’a pas « tenté de s’engager » (excellent officier de marine, il a repris du service, comme artilleur puis dans la propagande) ; en 1916, loin de partager la foi de Courteline en « la der des ders », beaucoup, comme Gustave Le Bon, prévoyaient déjà la suivante ; en 1918, la Grosse Bertha (en fait : trois canons près de Laon) n’a pas fait fuir les Parisiens…
L’homme et l’œuvre

Courteline vers 1900, (caricature de Léandre avec signature de Courteline).
Mais Mme Blancart-Cassou a une vraie sympathie pour son sujet : l’homme et l’œuvre. Elle donne envie de relire Monsieur Badin, de lire Les Linottes, roman cent fois remis sur le métier (avec souvenirs de Montmartre, et dans la dernière version, le personnage rajouté du juif Gütlight), de dénicher L’œil de veau, où Courteline raconte ses souvenirs de collège (on peut le trouver dans le Boubouroche, Lidoire et Potiron du Livre de Poche, chez les brocanteurs).
courtelineL’ouvrage est abondamment illustré, avec notamment les caricatures de Léandre (dont l’image de couverture), de Moloch, de Sem (p. 120) – il manque Steinlen. On y trouve même, à la dernière page, le blason que s’était composé Courteline (il dessinait) : ses deux grands-pères tourangeaux sont évoqués, l’un par le pot à colle de l’ébéniste, l’autre par la carotte du buraliste. Notons à ce propos que, si l’auteur fut un fils et petit-fils prévenant, un ami apprécié quoiqu’irascible et procédurier, on est un peu moins édifié par son comportement vis-à-vis de sa descendance. Il a certes régularisé ses deux liaisons, la première avec une jeune actrice, Berthe Fleury (dite Suzanne), juste avant qu’elle ne meure de phtisie, lui laissant deux enfants ; la seconde avec Judith Bernheim (dite Marie-Jeanne). Mais il n’éleva pas lui-même sa progéniture, semble s’être peu intéressé à Lucile (devenue très tôt Mme Ragot, à Mantes, pays de sa mère, et qui eut trois enfants) ; peut-être davantage à André, qui fut comédien et mourut peu de temps après lui.
Et la politique ? En 1896, quand éclate l’affaire Dreyfus, tout pousse Courteline vers le dreyfusisme, son éducation laïque, son protecteur Catulle Mendès, son ami Jules Renard. Mais il va éviter, comme Mallarmé, comme Alphonse Allais, comme surtout la plupart des hommes de théâtre, de signer quoi que ce soit. Ah ! ne me brouillez pas avec Léon Daudet, ce joyeux compagnon, ni surtout avec Jules Lemaître, qui me consacre de si bons feuilletons ! Il s’est tenu aussi à l’écart du combisme, contrairement à Renard ou Loti, et de tout anticléricalisme agressif. Il demande un prêtre au moment de mourir (amputé des deux jambes, comme trente ans plus tard un autre humoriste, Cami) : « L’immortalité ? J’y crois, parce que sinon ce serait trop bête. »
Sic transit…
On imagine mal ce que fut la gloire de Courteline à la fin (et non « au tournant », anglicisme qui n’a pas de sens en français) du XIXe siècle. Et plus encore dans les années 1910. Charles Schweitzer, grand-père de Jean-Paul Sartre (et accessoirement oncle du futur Docteur Schweitzer), « condamnait en bloc ses contemporains, à l’exception d’Anatole France et Courteline », lit-on dans Les Mots, où Sartre raconte aussi qu’on lui fit écrire une lettre au grand homme, en 1912. Charles Schweitzer admirait l’écrivain, mais un vaste public préférait l’homme de théâtre, qui jouait parfois lui-même ses pièces, et le conférencier international. On n’hésitait pas à le qualifier de moderne Molière. Le 11 novembre 1918, c’est à lui qu’on demande de lire « le communiqué de la victoire, signé du général Pétain » dans le hall du quotidien marseillais Le Soleil du Midi où il se trouve de passage.
8685-p7-courtelineLe cinéma, de 1912 à 1959 (puis plus rien !), lui a fait un triomphe, tous les grands acteurs comiques ont joué un de ses personnages, de Raimu à De Funès ; et les grandes actrices de Ginette Leclerc à Arletty (2). Apothéose : courtelinesque est devenu un adjectif d’usage courant, mais, notre époque étant tragique, kafkaïen tend à le remplacer. Feuilletons les histoires de la littérature. En 1936, Thibaudet ne daigne nommer ni Allais ni Feydeau, mais déclare sans sourciller : « Comme Rabelais et Molière, Courteline a bâti sur le roc. » En 1947, Henri Clouard accorde trois pages à l’auteur de Boubouroche, contre une demie à Feydeau… et une ligne à Alphonse Allais. Kléber Haedens a inversé les proportions dans Une Histoire de la Littérature française… mais pas en 1943, – seulement dans la réédition de 1970 (3).
Aujourd’hui, quelques titres restent dans la mémoire, les gaîtés de l’escadron, les ronds-de-cuir, le commissaire est bon enfant ; quelques-uns de ses personnages font encore référence, l’adjudant Flick, le père Soupe… Mais peut-être pas dans les jeunes générations, malgré l’édition d’un petit classique Larousse pour les classes de collège en 2012… Dès 1963, Jean-Claude Carrière (cité par Mme Blancart-Cassou) notait qu’il est « soudain devenu illisible », contrairement à ses contemporains Alphonse Allais ou Jules Renard, à cause d’une certaine complaisance pour la rhétorique de son temps, même s’il l’utilise de façon parodique.
Le fait est que Courteline n’a pas créé un style. On ne relira pas ses grands romans d’un bout à l’autre. J’ai tenté l’expérience avec Messieurs les Ronds-de-cuir, et je suis tombé sur Letondu, qui s’entraîne au lancer du disque dans son vaste bureau, belle préfiguration du Gaston Lagaffe de Franquin (4). Mais je n’ai pas poursuivi… Descriptions et dialogues manquent de rythme. Certaines nouvelles retiennent mieux l’attention. J’ai voulu ainsi lire Le Fils, dont Gide disait en 1923 : « Ç’aurait pu être traité par Dostoïevski ». Mais c’est finalement trop gentil. Les grands écrivains sont méchants !
Robert le Blanc – Présent
(1) Courteline, éd. Pardès (44 rue Wilson, 77880 Grez-sur-Loing), 128 p. (dont 6 pages de chronologie, filmographie, etc.), 12 euros.
(2) On peut encore voir, grâce au DVD, Raimu, Gabin et Fernandel en tourlourous, Michel Serrault en rond-de-cuir.
(3) Il est vrai qu’il faudra peut-être un jour se décider à classer la farce (de Pathelin à Ionesco) et le vaudeville (de Vadé à Feydeau) avec le cinéma et autres arts de la mise en scène et du dialogue, plutôt qu’avec la littérature.
(4) De même la partie de cartes de Pagnol rappelle celle de Boubouroche (1893), pièce que Jules Moinaux, le père de Courteline, méprisait parce que… « ça se passe dans un café ».
Robert le Blanc