Bison futé a annoncé une journée noire sur les routes de France, ce 10 août. Voilà une couleur qui convient bien à cette date. Il y a quelques semaines, la fête nationale du 14 juillet commémorait, non la journée sanglante de 1789, mais la fête de la Fédération qui, un an plus tard, réconciliait les Français dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle, alors que l’essentiel des réformes qui apparaissent aujourd’hui comme le bilan positif de la Révolution était accompli. « L’essentiel a été dit le 4 août » affirme François Furet qui souligne par là que la révolution libérale avait brisé les monopoles, aboli les privilèges, et mis de l’ordre dans le maquis des règlements et du droit. On aurait pu et dû en rester là, avec simplement la tension provoquée par le gigantesque transfert de propriété qui résulte de la vente des « biens nationaux », auparavant propriété du clergé et du domaine royal. Celle-ci a été le contraire d’une nationalisation, puisque les biens appartenant aux deux grandes institutions que sont l’État et l’Église ont été vendus à des particuliers. Ceux-ci en feront parfois bon usage sur le plan économique. Le développement de l’industrie cotonnière dans notre pays lui devra beaucoup. Jusqu’à la Restauration, et au-delà, avec l’affaire de l’indemnisation des émigrés, dont les biens auront également été saisis et vendus, la coalition des acheteurs sera le plus sûr rempart contre un retour de l’Ancien Régime.
Le 10 août 1792 est le jour où la Révolution française montre hélas sa nature spécifique et consacre un échec que notre discours officiel et notre enseignement cherchent désespérément à cacher ou à oublier en prétendant qu’elle est « un bloc ». Deux siècles et quelques années plus tard, après une douzaine de régimes, et la volonté chez certains d’instaurer une sixième république, le bilan est négatif. Si l’on considère la Révolution comme un bloc, on doit se souvenir qu’elle a inspiré par son sens et par ses pires méthodes, la révolution bolchévique qui s’en voyait le prolongement prolétarien et trouvait dans la Terreur le modèle de son action. Le génocide vendéen annonce l’Holodomor ukrainien sous Staline. De manière plus sourde, l’une des particularités de la gauche française est sa haute teneur en poison idéologique si on la compare aux autres gauches européennes, plus pragmatiques. Il y encore chez nous cette idée issue de la révolution jacobine de changer la société et pour cela de façonner l’esprit des hommes qui la composent. C’est ainsi que Mme Belkacem et M. Peillon rêvent à haute voix de changer les mentalités, y compris en imposant l’idéologie du « genre » à l’enseignement libre » au mépris de son caractère propre reconnu par la loi. Un gouvernement doit assurer le bien public. Il n’a pas à intervenir dans la pensée et peser sur les consciences, sauf à être totalitaire dans la pure tradition du 10 août 1792. Les Américains ont fait leur révolution quelques années avant nous, avec le soutien de l’Armée royale. Les Britanniques en ont fait deux, la seconde, un siècle avant la nôtre. Ils n’ont plus changé de régime depuis et aucun de leurs gouvernements ne se croit en charge de décider de la pensée des citoyens.
Le 10 août 1792, c’est l’illustration la plus magistrale de ce qu’écrit encore François Furet : « la période qui va de mai-juin 1789 au 9 thermidor 1794 n’est pas caractérisée par le conflit entre la Révolution et la Contre-révolution, mais par la lutte entre les représentants des Assemblées et les militants des clubs. » Au travers des « journées » et des émeutes, les Jacobins vont imposer la domination d’une « société de pensée » à un pays dont on a détruit la capacité de résistance en faisant disparaître son organisation en « corps ». C’est donc une minorité agissante qui va l’emporter sur les instances censées représenter la majorité. Cela aura trois conséquences négatives. D’abord, ce premier rendez-vous manqué avec la démocratie représentative pèsera sur la suite de notre histoire. Ensuite, ce recours à la violence où à la force, au « coup » d’État ou non, sera assez constant jusqu’à un certain 13 mai 1958, malgré la longue parenthèse entre la Commune et la Première guerre mondiale, où les héritiers des Jacobins prennent le pouvoir et le conservent en ne manquant pas de s’attaquer à la liberté religieuse. Enfin, subsistera, de manière plus ou moins avouée à gauche, l’idée que la légitimité procède du « progrès », de ce sens de l’histoire qu’a incarné la Révolution par son glissement à gauche jusqu’à la terreur.
Le 10 août 1792, préparée par un Comité d’insurrection, soutenue par une Commune insurrectionnelle, l’attaque des Tuileries est menée par les volontaires nationaux, les « fédérés » et les sections parisiennes qui massacreront les défenseurs, les gardes suisses, notamment, lorsque ceux-ci cesseront leur résistance sur l’ordre du Roi. Celui-ci sera suspendu et emprisonné au Temple. Deux ans de cauchemar vont suivre marqués par les règlements de compte entre les factions et les individus, Girondins et Jacobins, Danton et Robespierre, le premier responsable des massacres de Septembre, l’autre de la Grande Terreur. La Convention est sans doute l’époque la plus noire de notre histoire sur le plan intérieur. En revanche, cette république calamiteuse sera sauvée par l’élan de la Nation et par ses victoires militaires. Valmy n’a pas été une grande bataille, mais c’est un grand événement qui a deux faces : d’abord, c’est la réaction d’une Nation à laquelle l’étranger veut dicter sa loi. Le stupide manifeste du duc de Brunswick promettant de livrer Paris à une exécution militaire avait été le détonateur du 10 août. Valmy est la réponse de la France au roi de Prusse. Mais, ensuite, la guerre a changé de sens. Sous l’Ancien Régime, les guerres n’étaient que des moyens d’accroître les territoires soumis aux monarques. Les mariages ou les alliances étaient d’autres moyens. Désormais, la guerre va prendre un tour idéologique. Les révolutionnaires haïssaient l’Autriche, dont la monarchie française s’était rapprochée par le mariage de Louis XVI avec Marie-Antoinette. Ils avaient de la sympathie pour la Prusse et surtout pour l’Angleterre, pourtant nos véritables ennemis. Ces pays vont certes combattre la contagion révolutionnaire, mais ils vont surtout continuer leur politique ancienne, comme en témoignent les partages de la Pologne en 1793 et 1795. Les Français vont au contraire inaugurer des guerres idéologiques appuyées sur la conscription générale. Le 10 août marque donc une rupture, désastreuse pour notre pays et sans doute aussi pour l’Europe.




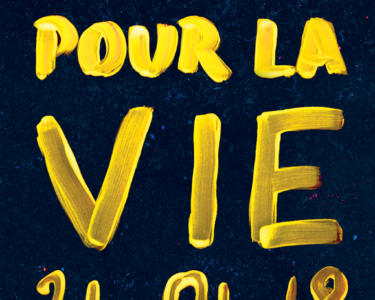
37 Comments
Comments are closed.