Le 27 juillet 1214, il y a 800 ans, Philippe Auguste menait ses troupes à la victoire de la célèbre bataille de Bouvines qui élabora l’unité française. Voici un extrait du récit de ce grand jour qu’a fait Antoine Hadengue dans son livre Philippe Auguste et Bouvines (Ed. Taillandier, 1977):
Or, sous son frêne, près de sa source, ses armes couchées sur le gazon, Philippe se restaure et se repose. Soudain, un cavalier dévale du plateau. C’est frère Guérin. Sans doute l’évêque de Senlis, infatigable et vigilant, est-il resté en observation sur la crête; il a vu de loin ce qui se passait :
— Que faites-vous, dit-il ?
— Eh bien, fait le roi, je dîne.
— C’est bon, reprend Guérin, mais il faut vous armer, car ceux de là-bas ne veulent pas du tout remettre la bataille à demain. Ils la veulent tout de suite. Venez voir : ils viennent sur nous. (…)
Déjà, Philippe est debout. Il lève les yeux ; au Christ, à saint Denis, à « Dame sainte Marie », il jette une imploration — pour lui, et pour «tous ceux, à pied et à cheval, qu’il a amenés avec lui ». Ses fidèles, ceux de sa maison, l’entourent. A ces compagnons de cent périls, il tend les bras comme à des frères ; il embrasse Michel de Harnes, il embrasse Gérard La Truie ; une tendresse lie ces coeurs de bronze. (…)
Aussitôt, traversant la route, le roi pénètre dans l’église de Bouvines.Il dépose un instant sur les marches de l’autel son heaume et son épée.Il s’agenouille et joint les mains, adressant à Dieu cette « oraison » fière et naïve :
— Seigneur, je ne suis qu’un homme, mais je suis le roi de France C’est à vous de me garder. Gardez-moi et vous ferez bien, car par moi sous ne perdrez rien.Chevauchez, je vous suivrai et partout après vous j’irai.
Si on se bat le dimanche, c’est la faute de l’ennemi. Et comment le Seigneur ne bénirait-il pas ses « champions», en ce jour où l’Église entière l’implore pour eux ?
Philippe sort du sanctuaire. Dieu, il le sait, fera sa tâche ; à lui maintenant de faire la sienne. Il envoie l’ordre aux Communes de faire demi-tour et de repasser la rivière au plus vite. II endosse l’armure de bataille, assure son casque et saute en selle, « rayonnant de joie, dit le chroniqueur, comme s’il se rendait à une noce ».Cependant les chevaliers s’empressent. Partout sonne le ralliement. On serre les sangles. Les épées jaillissent des fourreaux. Les grands vassaux courent se placer à la tête des escadrons qui s’ébranlent. « Lors commença-t-on à crier parmi les champs : Aux armes, barons, aux armes! Trompes et buccines commencièrent à bondir… »
Et le roi de France, «haut sur son haut destrier» — alto altus equo —, prend le galop dans un tourbillon de poussière, de reflets d’acier et de fanfares : (…)
Comme le dit, non sans fierté, l’Anonyme de Béthune, Philippe « ordena molt sagement et molt seurement son affaire, et non esbaiement (en perdant la tête) ».
L’essentiel, c’était d’abord que l’arrière-garde continuât à tenir assez longtemps pour couvrir le retour et le déploiement de l’armée. Philippe y courut. Sa présence, révélée aux amis et aux ennemis par l’apparition du pennon royal, rétablit l’ordre parmi nos gens qui commençaient à fléchir sous la pesée du nombre. Les impériaux, ne pouvant plus compter sur l’effet de surprise, rompirent le combat pour prendre d’autres dispositions. Payant de sa personne et prêchant le sang-froid par l’exemple, le Capétien les surveillait de si près qu’entre eux et lui, dit le Breton, «il n’y avait pas un seul combattant ». Puis, rassuré de ce côté-là, il revint vivement au milieu de la plaine et prit place sur le front des troupes qui se rangeaient en bataille. (…)
Heureusement le désordre régnait dans l’armée d’Othon. Trop assurée de vaincre, sa précipitation l’avait désunie. Les Flamands s’étaient lancés en enfants perdus et les autres contingents, plus ou moins animés par une ardeur inégale, plus ou moins retardés par les accidents de leur parcours, ne les avaient rejoints qu’en groupes successifs. Bref, une attaque décousue et menée par des hommes hors d’haleine. Un chroniqueur flamand conviendra que si l’Empereur fut défait malgré sa supériorité numérique, ce fut parce qu’il «.assembla à bataille trop beubanchièrement (en confusion, à l’étourdie) et sans tenir convoy ». (…)
Quand la tête de colonne des coalisés approcha de la vallée de la Marcq, au nord de Bouvines, notre gauche s’appuyait déjà aux marécages et le passage vers le pont était intercepté. Dès lors, les deux armées, immobilisées, se trouvaient établies parallèlement l’une à l’autre. de l’orient à l’occident les Impériaux s’allongeant sur la crête septentrionale du plateau, depuis le lieu ou s’était arrêtée leur avant-garde jusqu’à la vallée — et les Français prenant position le long de la chaussée romaine, depuis la vallée jusqu’au lieu où s’était arrêtée leur arrière-garde.
Les premiers se tournant vers le sud, les seconds vers le nord, ils se dévisageaient front contre front, en ligne de bataille, à une portée d’arbalète, séparés seulement par une dépression très légère dont la double pente ajouterait tout à l’heure à leur élan.
Les coalisés pensaient écraser une foule en désarroi. A voir la volte-face, le déploiement et la résolution des Français, ils furent « tout esbahis et surpris de soudaine peur ». Le gibier montrait les dents… Othon n’avait pas compté là-dessus. Il se mit en colère
– Que me disait-on, s’écria-t-il, que le roi de France était en fuite ?… Voici que je vois son armée rangée dans un ordre imposant, toute disposée à en venir aux mains.
– Je vous avais annoncé ce qui arrive, repartit aigrement Renaud. La coutume des français à la guerre n’est pas de fuir, mais de mourir ou de vaincre…
(Merci à EVR)




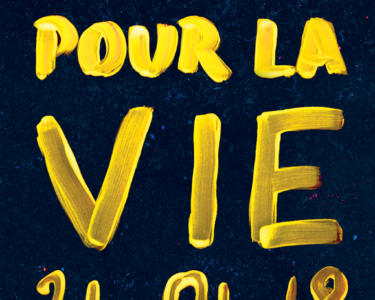
4 Comments
Comments are closed.